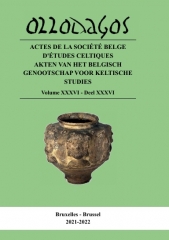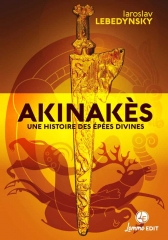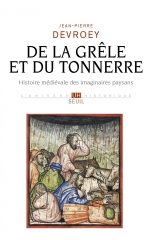 Jean-Pierre Devroey, De la Grêle et du tonnerre. Histoire médiévale des imaginaires paysans, 2024, Paris, Seuil.
Jean-Pierre Devroey, De la Grêle et du tonnerre. Histoire médiévale des imaginaires paysans, 2024, Paris, Seuil.
Jean-Pierre Devroey est un historien médiéviste bien connu, spécialiste des sociétés rurales du haut Moyen Âge: on pourra donc s’étonner de lire dans le cadre de Nouvelle Mythologie Comparée un compte rendu de son dernier livre. Cependant, celui-ci s’intéresse à l’histoire des croyances dans les campagnes carolingiennes, en prenant pour base le fameux traité d’Agobard de Lyon, De grandine et tonitruis (De la Grêle et du tonnerre), rédigé vers la fin du premier quart du IXe siècle, et notamment la fameuse anecdote des gens qui viendrait d’un mystérieux pays aérien nommé Magonia, lesquels naviguent à bord de bateaux sur les nuages et achètent aux tempestaires les récoltes détruites par les intempéries1.
Cependant, l’auteur va bien au-delà de cette seule anecdote et aborde l’ensemble du traité d’Agobard pour tâcher d’une part de rassembler ce que l’on sait des croyances dans les campagnes d’alors, sur les orages, sur les tempestaires, sur les saints qui ont une influence sur la météorologie, sur les moyens engagés pour se rendre propice cette météorologie, non seulement à l’époque carolingienne, mais aussi à des époques plus tardives: Jean-Pierre Devroey fait en effet partie de ces historiens qui pratiquent le temps long, et il n’hésite pas à employer jusqu’aux travaux des folkloristes du XIXe siècle afin de s’exercer, avec beaucoup de prudence, à l’histoire régressive quand cela est nécessaire pour combler les lacunes de la documentation alto-médiévale.
Il ne sera pas question dans le présent compte rendu, des parties purement historiques de l’ouvrage: elles n’entrent pas dans le thème de notre revue. Je me contenterai de dire qu’on a là un essai particulièrement solide, très bien sourcé et documenté. En revanche, je m’attarderai sur les parties concernant les récits légendaires et les phénomènes qu’on pourrait continuer d’appeler «folkloriques», à savoir les croyances sur l’orage lui-même, et sur le pouvoir des tempestaires. Jean-Pierre Devroey le démontre bien: la totalité de la société dont il est question est chrétienne. Il est absolument vain de vouloir voir dans les sorciers, les tempestaires, ou bien les personnes employées par les communautés rurales pour chasser les orages, une quelconque survivance du paganisme, même si ces personnages peuvent employer des méthodes et techniques issues du paganisme. Les communautés rurales carolingiennes, notamment celles du Lyonnais, sont chrétiennes dans leur ensemble, même s’il peut s’agir d’un christianisme populaire, non encadré par le clergé2.
Cependant ce constat est peut-être poussé un peu trop loin par Jean-Pierre Devroey, car il se coupe quasiment totalement d’éventuelles racines antiques de ces croyances et légendes. Ainsi, lorsqu’il aborde le cas de la mise en place de processions, notamment dans les campagnes, à la suite de l’instauration des Rogations au Ve siècle par saint Mamert de Vienne, il semble écarter tout phénomène similaire dans le paganisme local (p. 211-214). Pourtant, j’ai pu identifier au moins quatre cas de processions antiques en territoire celtique antique : une est mentionnée par Sulpice Sévère dans la Vie de saint Martin (12, 1-5: Martin croit voir une idole menée en procession à travers champs); l’auteur anonyme de la Passion de saint Symphorien d’Autun signale une procession en l’honneur de Berecynthia (Cybèle); une inscription celtibère de Peñalba semble mentionner une procession en l’honneur de Lugus, si l’on suit l’interprétation proposée par Wolfgang Meid3; enfin à l’époque carolingienne, Heiric d’Auxerre nie dans une de ses homélies, que les circumambulations chrétiennes aient été inspirées de pratiques païennes homologues, ce qui atteste cependant de leur existence4.
Le même problème se pose lorsque l’auteur s’intéresse directement au cas de Magonia, ce pays fabuleux mentionné par Agobard (p. 145-170). Jean-Pierre Devroey, qui n’est pas linguiste, se garde bien, et on le comprend, se proposer sa propre étymologie du nom. En revanche, il rappelle les étymologies proposées par le passé, donnant sa préférence à magus («mage») et au latin tardif *mango («marchand»). Le second est invoqué car il y a bien un accord commercial entre les tempestaires et les habitants de Magonia. Cependant, il pose de sérieux problèmes de phonétique historique. Magus est plus intéressant, mais on peut ici se demander jusqu’à quel point ce terme étranger a pu pénétrer dans les campagnes de Gaule jusqu’à générer une croyance en un «pays des mages».
Il serait sans doute plus intéressant de considérer un substrat linguistique celtique. Or deux mots gaulois pourraient ici faire sens: magos, «champ, plaine», plus tard «marché», qui intervient dans de très nombreux toponymes un peu partout dans l’actuelle France, et magus, «garçon, jeune, valet», qu’on retrouve dans de nombreux anthroponymes antiques, dont Magunia5. N’étant pas linguiste, je me garderai bien de trancher, mais chacun des deux conviendrait du point de vue phonétique, d’autant plus que la forme donnée par Florus de Lyon, contemporain d’Agobard, Maonia, et le nom donné à des démons tempestaires mentionnés par Florus lui-même et trois autres sources du haut Moyen Âge (maones, mauones, hemaones, ce dernier donné par la Vita prima de saint Riquier en compagnie des dusi, nom bien gaulois de démons), montre un phénomène d’amuïssement du «g» intervocalique qui a eu lieu, on le sait notamment grâce aux toponymes dérivés de magos, dès le très haut Moyen Âge. Magos comme magus entrent par ailleurs en composition de théonymes celtique (gaulois Magiae et Magiseniae, irlandais Macha, pour magos; gaulois Magusanus, pour magus). Et pour complexifier les choses, les deux peuvent chacun se rapprocher de noms irlandais de l’Autre Monde: Mag Mell («Plaine de la Joie») ou Tír na nÓg («Terre de Jeunesse»). De la même manière, il a bien été noté que tous les exemples anciens de récits mettant en œuvre des navires dans le ciel viennent des îles britanniques6. Il me semble donc clair qu’une origine celtique païenne des croyances notées par Agobard ne doit absolument pas être écartée.
Mais au-delà de ces quelques réserves, il faut bien noter que le livre de Jean-Pierre Devroey est absolument brillant, par sa volonté d’une histoire totale, qui embrasse la légende, les croyances qui lui sont associées, mais aussi et surtout le milieu dans lequel tout cela existe et la manière dont l’Église y a réagi à travers le temps. Il s’agit là d’une véritable leçon d’histoire, et donc d’un ouvrage incontournable.
Patrice Lajoye
1Agobard de Lyon, Œuvres, t. 1, 2016, Paris, Cerf.
2C’est là un constat qui se maintiendra à travers le temps, comme je l’ai écrit au sujet des sorciers et guérisseurs normands du XIXe siècle: «En définitive, les pratiques des sorciers et guérisseurs normands sont toutes chrétiennes. […] L’Église condamne la sorcellerie, c’est du moins sa position officielle. Mais cela n’empêche pas des prêtres de pratiquer des exorcismes, des désensorcèlements, ou de se faire guérisseurs. Inversement, on ne connaît pas de cas de sorcier affrontant un prêtre ou l’Église. S’il y a opposition de l’Église, la réciproque n’est pas vraie. Les pratiques des sorciers et des guérisseurs relèvent d’un christianisme déviant mais populaire. Dans les faits, sorciers et guérisseurs disent des prières, des oraisons, font dire des messes, ordonnent des neuvaines ou des pèlerinages, voire les effectuent eux-mêmes, se servent de sel et d’eau bénites, font le signe de la croix, utilisent donc tout ce que le christianisme a de symboles forts. La société ne les aurait sans doute pas tolérés s’il en avait été autrement» (Patrice Lajoye, Sorciers et guérisseurs au XIXe siècle. Enquête en Basse-Normandie et dans les îles anglo-normandes, 2024, Lisieux, Lingva, p. 185-186).
3Wolfgang Meid, Celtiberian Inscriptions, 1994, Budapest, Archaeolingua.
4Patrice Lajoye, «Les processions et circumambulations chez les Celtes de l’Antiquité», Mythologie française, 218, 2005, p. 22.
5Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental, 2003, Paris, Errance, p. 214.
6Juan Antonio Jiménez Sánchez, «Los barcos de Magonia y otros navíos voladores como género de mirabilia durante la Edad Media», in Anna Orriols i Alsina, Jordi Cerdà Subirachs, Joan Duran Porta (éd.), Imago & mirabilia: les formes del prodigi a la Mediterrània medieval, 2020, Barcelone, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 153-162.