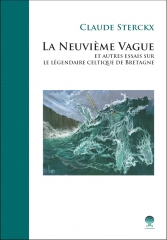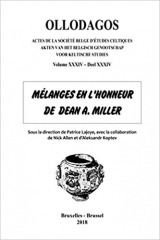Patrice Lajoye (ed.), New Researches on the Religion and Mythology of the Pagan Slavs, 2019, Lisieux, Lingva, 224 p.
Patrice Lajoye (ed.), New Researches on the Religion and Mythology of the Pagan Slavs, 2019, Lisieux, Lingva, 224 p.
Constatant, dans son introduction, que rien de sérieux n’est paru depuis longtemps en langue anglaise sur la religion et la mythologie des Slaves païens, l’anthologiste du présent recueil a réuni plusieurs études tournant autour de cette thématique.
Cet ouvrage s’ouvre par un article de Jiří Dynda sur les «Slavic Anthropogony Myths. Body and Corporeality in the Slavic Narratives about the Creation of Man». Du fait de l’absence de mythes anthropogoniques slaves remontant directement aux temps pré-chrétiens, l’auteur a examiné les traditions apocryphes et folkloriques à la recherche de la strate païenne de ce type de mythème, en utilisant la comparaison mythologique1. Il en tire comme conclusion que la version pré-chrétienne de l’anthropogonie slave devait mettre en jeu la chute sur terre d’un élément corporel ou un objet ayant été en contact avec le corps de la divinité créatrice.
Alexander V. Ivanenko se penche, dans Towards the PSl. *Stribogъ origin», sur le dossier de ce théonyme. Après avoir présenté l’ensemble de ses attestations, les différentes étymologies précédemment proposées et leurs interprétations théo-mythologiques, il propose de voir dans *Stribogъ un emprunt à l’iranien oriental *S(t)rī-baγa dont la signification serait celle de «Seigneur des vents» et qui aurait été non seulement le contrôleur des vents, mais également une divinité tonnante, à la manière du Papay révéré par les Scythes, d’après Hérodote. Ivanenko évoque l’adoption de cette divinité par les proto-Slaves vers le Iersiècle de notre ère, à une époque où ceux-ci étaient en contact avec les Scythes, sur les bords septentrionaux de la Mer noire. On peut se poser la question du caractère tonnant de cette divinité et du rapprochement fait avec l’équivalent scythe du Zeus grec, car une telle divinité, adoptée par le prince rus’ Vladimir Ier parmi les cinq principaux dieux du début de son règne, fait double emploi avec Perun, le dieu panslave de la foudre. On peut néanmoins se demander si ce théonyme d’origine iranienne n’a pas pu recouvrir un nom antérieur d’un dieu des vents slaves équivalent au Vayu-Vata indo-iranien.
C’est au dossier d’autres divinités que s’intéresse Oleg V. Kuratev dans «Description of Rod and Rožanicy in Slavic mythology. B. A. Rybakov and his predecessor’s interpretations». Comme le titre de cette contribution l’indique, l’auteur rappelle l’interprétation de Rybakov de Rod, en tant que divinité suprême du paganisme slave ancien – véritable fondement du l’actuel mouvement néo-païen slave, pour mieux la critiquer. Il montre, en se basant sur la comparaison avec des figures équivalentes, existant chez des peuples slaves autre que ceux de l’Est, et sur l’étude étymologique du nom de ces divinités que Rod est sans doute un dieu ancestral lié à l’idée de destin que semblent incarner ses partenaires féminines, les Rožanicy.
C’est le versant matériel du thème de ce recueil qui est exploré par Kamil Kajkowski, dans «Idols of the Western Slavs in the Early Medieval period. The example of Pomerania (northern Poland)». Il en tire comme bilan que, sur la vingtaine de sculptures poméraniennes traditionnellement identifiées comme étant des idoles, aucune ne peut être véritablement relié à un contexte archéologique permettant ainsi de les associer avec une époque et/ou une culture particulière. De plus, l’authenticité de certaines est douteuse.
De son côté, la contribution de Stamatis Zochios porte sur «Slavic deities of death. Looking for a needle in the haystack». L’auteur y analyse les différentes mentions de divinités en lien avec la mort dans les textes parlant des Slaves pré-chrétiens, tout en distinguant bien leur relation à la dimension funéraire. Il en conclue que même si ces divinités sont en lien avec la mort ou plus exactement le cycle naturel, on ne peut pas identifier de seigneur du monde des morts dans les sources mythologiques slaves.
Marina M. Valentsova, quant à elle, étudie le «Slovak mythological vocabulary on the Common Slavic background. Ethno-linguistic aspect». Du fait de la position centrale de cette langue vis-à-vis des langues slaves, elle montre les liens existant entre les différentes strates constitutives de l’onomastique légendaire slovaque et celui des autres cultures slaves.
Aleksandr Koptev s’intéresse, pour sa part, au «Mythological triadism as the paradigm of princely succession in early Rus’ according to the Primary Chronicle». En effet, les sources slaves, que se soit les chroniques ou les contes, parlent souvent de trois princes fondateurs. Il relie ce motif au mythème indo-européen du troisième frère, le plus jeune, qui doit vaincre le triple adversaire et qui , parfois, entre en conflit avec ses aînés. Ce thème symbolise aussi une triple division du temps et de l’espace. Dans ce dernier, cas une présentation triadique des peuples ou des principales cités apparaît également. Cependant, notre auteur montre aussi qu’un fonctionnement triadique du royaume des Rus’ devait effectivement exister. Par la suite, ce motif triadique a été étendu aux règnes plus ou moins légendaires des premiers souverains rus’ dans le Récit des temps passés; questionnant par là-même la logique d’écriture à l’œuvre dans ce texte pseudo-historique.C’est un article dense, en particulier dans son analyse historique des différents règnes triadiques: un tableau généalogique aurait pu aider à la compréhension générale de son propos.
Le sujet de la contribution de Patrice Lajoye concerne l’aspect sacré et mythique de la souveraineté dans «Sovereigns and sovereignty among pagan Slavs». Après avoir rapidement rappelé l’historiographie de la notion de souverains chez les Slaves, notre auteur fait la liste des différents titres par lesquels les auteurs, Slaves ou non, appelaient ceux-ci.Ces termes apparaissent souvent emprunté à des langues voisines, mais il pourrait exister un nom local du souverain, *Samovit, qu’il compare au sanskrit samrāj et au gaulois Samorix, deux désignations du roi suprême. Il poursuit par un examen de trois mythèmes expliquant l’origine des lignages royaux chez les Slaves: celui du roi-laboureur, celui des trois frères étrangers et, pour finir, celui des trois frères et de la sœur incarnant la souveraineté. Ces traditions permettant à notre auteur certaines comparaisons avec le matériel iranien, arménien et surtout celte.
Enfin, cet ouvrage se termine par «Some aspects of pre-Christian Baltic religion» de Roman Zaroff. Contrairement aux autres études de ce recueil, il ne concerne pas les traditions des Slaves pré-chrétiens – sauf d’un point de vu comparatif – mais les croyances des peuples Baltes, les derniers païens d’Europe, et, en particulier, des Vieux-Prussiens, les habitants pré-germaniques de la Prusse. Dans une première partie, Zaroff décrit l’organisation socio-politique des peuples baltes et leur conversion au christianisme, tout en présentant les sources et la méthodologie utilisée dans cette étude. C’est une mise au point tout à fait utile, du fait du manque de connaissances, en Europe occidentale, de ces notions. Au passage, l’auteur se permet une critique pertinente des velléités reconstructives des mouvements néo-païens baltes. Dans un second temps, notre auteur étudie le panthéon des Vieux-Prussiens, par comparaison avec celui du reste des populations baltes et des autres cultures indo-européennes. Concernant la divinité solaire des Vieux-Prussiens, le fait qu’elle soit masculine alors que les peuples baltes actuels ont une déesse-soleil est interprété comme une évolution du sexe de la divinité solaire dans un sens ou dans l’autre. Une solution alternative est de considérerqu’il a existé une variation régionale sur le sexe de la divinité solaire, entre les Baltes occidentaux (Vieux-Prussiens) et orientaux (Lithuaniens, Lettons). Enfin, cette étude se conclutpar une analyse des lieux de cultes, du clergé et des idoles des Baltes.
Toutes les contributions du présent recueil sont intéressantes pour qui veut approfondir, de manière scientifique, sa connaissance de la religion des Slaves et des Baltes pré-chrétiens.
Guillaume Oudaer