Comparative Mythology, 5, 2019, 82 p., Cambridge, International Association of Comparative Mythology, http://compmyth.org/journal/ ISSN 2409-9899.
Attendu depuis près de trois ans, le nouveau numéro de Comparative Mythology vient de paraître. Les éditeurs de cette revue ont choisi de faire de ce volume le cinquième et non le troisième, en vertu du millésime : 2019 est la cinquième année depuis la fondation de la revue. Cependant, il ne s’agit que d’un détail bibliographique insolite que la qualité du contenu de ce numéro fait rapidement oublier.
Ainsi, ce volume s’ouvre par «The Legacy of the Berserker» de John Colarusso. Prenant comme point de départ la caractérisation du berserker dans la Hrólfs saga kraka, il en analyse les principaux attributs: le fait qu’il se tienne à l’écart des autres combattants – sans doute à cause de sa transe guerrière; sa proximité avec le roi; le port de la fourrure de l’animal qu’il a tué; et un comportement insultant et provoquant envers tout nouvel arrivant quel que soit son statut. De telles caractéristiques semblent, selon l’auteur, avoir influencé la figure indo-européenne du héros, à travers la figure du combattant solitaire, par choix ou abandonné par ses camarades, à l’animosité inexpliquée desquels il doit faire face. Selon lui, une telle influence est visible dans le cas d’Achille, dont la colère injurieuse vis à vis d’Agamemnon, entraînant sa réclusion, fait suite une véritable furie meurtrière sur le champs de bataille, digne d’un berserker nordique. De même, la rage homicide et psychotique de ces guerriers se retrouve dans celle d’Héraclès tuant sa femme et ses fils. Les excès de ce type de comportement sont stigmatisés dans des cultures qui ne les comprennent plus, comme en Grèce, lorsque Tydée dévore le cerveau de Mélanippe ou quand Ajax décime les troupeaux des Achéens et leurs gardiens en croyant, dans une rage vengeresse, qu’il s’agit des guerriers grecs. De même, la chaleur dégagée par certains héros dans leurs exploits guerriers et son apaisement semblent aussi être le souvenir de la transe guerrière de ce type de combattants. Celle-ci pouvant amener à des contorsions permettant de lancer le mauvais œil sur l’ennemi. Notre auteur termine sur le caractère sacré, mais aussi psychotique, de ces guerriers. Les propositions de Colarusso nous semblent tout à fait séduisantes, mais elles auraient été d’autant plus intéressantes s’il les avait mis en parallèle avec d’autres études portant sur la colère d’un héros comme Achille ou sur la nature et l’apaisement de la furie guerrière1.
Dans «Cultic Calendar and Psychology of Time: Elements of Common Semantics in Explanatory and Astrological Texts of Ancient Mesopotamia», Vladimir Emelianov se penche sur les textes calendaires et astrologiques assyriens et babyloniens, qu’il analyse par le biais de la chronopsychologie. Il montre que les rituels et les prescriptions conseillés entre la partie sombre et celle lumineuse de l’année correspondent aux états psychologiques favorisés par le cycle psychobiologique annuel. Mettant en parallèles ces conseils mais aussi d’autres concernant les actes magiques et la correspondance microcosmique de chaque signe zodiacal, il en déduit que les érudits mésopotamiens ont relié le contenu mythologique et rituel de chaque mois aux prescriptions médicales et aux prévisions astrologiques, selon la logique du rapport macrocosme-microsme. De manière particulièrement intéressante et originale, il relie ses conclusions aux recherches récentes sur les rythmes biologiques saisonniers chez l’être humain, dont les résultats auraient pu être également observé par les médecins et astrologues mésopotamiens. L’utilisation de la psychologie et de la biologie dans ce cadre interprétatif nous semble tout à fait pertinent, en complément éventuel d’autres méthodes.
Retour à la mythologie indo-européenne avec «“Nine Nights” in Indo-European Myth» de Signe Cohen. Celle-ci avance que l’intervalle temporel de neuf nuits qui est fréquemment cité dans la mythologie et les rituels des cultures indo-européennes connote à la fois l’existence d’une semaine de neuf jours, dans le système calendaire ancien de celles-ci, mais aussi une symbolique liée aux forces de l’Autre Monde, aux idées de transformations, de mort et de renaissance. Ce système remontant aux temps proto-indo-européens serait basé sur le fait qu’une période de trois fois neuf jours est égal à la durée d’un mois lunaire. Cette étude tout à fait pertinente mériterait d’être mise en parallèle avec celle de Claude Sterckx concernant la neuvième vague, un intervalle spatial nautique qui possède le même type de symbolisme2.
De son côté, Kazuo Matsumura contribue épistémologiquement à ce numéro avec «Theories of Diffusionism: Myth and/or Science?», où, après avoir retracé l’historiographie de la théorie diffusioniste et de ses égarements initiaux qui tendirent à construire un mythe scientifique, il montre que la version actuelle de la théorie diffusioniste, à travers les travaux de Michael Witzel et de Yuri Berezkin, est basée sur des bases scientifiques plus solide, notamment grâce aux données culturelles et biologiques des migrations humaines, tout en se dépouillant des a priori idéologique de la période coloniale. La démonstration qu’il fait et convaincante et montre bien l’intérêt de ce nouveau modèle théorique qui, comme il le dit au début de cet article, n’est pas la vérité, mais un élément d’explication de la mythogénèse mondiale.
Épistémologie de notre discipline encore dans «Comparative Mythology Synchronic and Diachronic: Structure and History for Taryo Obayashi and Claude Lévi-Strauss», de Hitoshi Yamada, qui s’attache à comparer l’utilisation du structuralisme par l’ethnologue japonais Taryo Obayashi, dont la méthodologie semble, au premier abord, plutôt historique, avec l’utilisation de la science historique et de la théorie diffusioniste par Claude Lévi-Strauss. L’auteur montre également l’influence de la méthode d’analyse mythologique de Georges Dumézil sur l’œuvre d’Obayashi. Cette étude, nous montre là aussi, l’importance de la confrontation et de l’utilisation de différentes théories et méthodes dans le champs d’étude de la mythologie comparée qui, du fait de la complexité de l’esprit humain et des cultures qui en sont dérivées, ne peut reposer sur une unique théorie unificatrice des mythes.
Nicholas J. Allen termine les études de ce volume avec «Chronicle and Epic, or the Introductions to the Mahāvaṃsa and the Mahābhārata: Selected Comparisons». L’auteur étudie les schémas narratifs communs existant entre deux textes de natures différentes: le premier est une chronique bouddhiste Sri Lankaise, tandis que le second est une épopée hindou. Les parallèles qu’il dégage suscitent l’adhésion du lecteur. En conclusion, il se pose naturellement la question de l’origine de cette structure : la réponse la plus simple serait une influence de l’épopée sur la chronique oul’inverse. Cependant, l’auteur laisse la porte ouverte à une possible origine proto-indo-européenne de ce type de schéma narratif qu’il serait possible de déceler dans les textes épiques grecs ou la pseudo-histoire romaine. Comme il l’annonce d’emblée, cet article n’est que le début d’une plus longue étude comparative. Dans cette optique, il serait également intéressant d’étudier la structure des textes celtiques insulaires ou scandinaves, épiques ou pseudo-historiques : même si ceux-ci ont été influencé par le christianisme, il se pourrait que de telles similarités puissent être découverte, si l’hypothèse de départ de notre auteur est juste. De même, la tradition littéraire iranienne, encore plus proche du monde indien que la Grèce ou Rome, devrait aussi être prise en considération dans le cadre d’un tel projet.
Enfin, ce numéro se termine par la notice de nécrologique de Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov rédigée par Boris Oguibénine.
Guillaume Oudaer
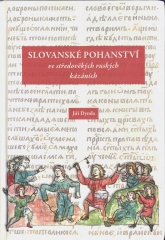 Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních, 2019, Prague, Scriptorium, 407 p.
Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních, 2019, Prague, Scriptorium, 407 p.