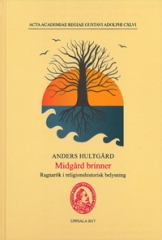 Anders Hultgård, Midgård brinner. Ragnarök i religionshistorisk belysning, 2017, Uppsala, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi – CXLVI).
Anders Hultgård, Midgård brinner. Ragnarök i religionshistorisk belysning, 2017, Uppsala, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi – CXLVI).
En 1998, dans le troisième volume de la revue Proxima Thulé, François-Xavier Dillmann annonçait que la collection Studia nordica, alors récemment créée, avait pour but de publier «des recueils de scripta minora et des monographies consacrées à la Scandinavie ancienne sous ses multiples aspects ainsi qu’aux régions qui furent colonisées par les peuples nordiques au cours du haut Moyen Âge» (p. 150). Parmi les volumes en préparation figurait celui d’Anders Hultgård, Le Crépuscule des dieux. Études comparatives sur les représentations de la fin du monde dans la Scandinavie ancienne et médiévale. En 2009, dans le sixième volume de la même revue, un article de M. Hultgård «Fimbulvetr ou le Grand Hiver. Étude comparative d’un aspect du mythe eschatologique des anciens Scandinaves» (p. 11-39) était publié. La rédaction de la revue indiquait en note que l’auteur préparait un ouvrage «sur les mythes eschatologiques de la Scandinavie ancienne» (p. 11).
Le livre d’Anders Hultgård, Midgard brûle. Le Ragnarök à la lumière de l’histoire des religions est donc le résultat d’au moins deux décennies de travail de recherche. C’est une véritable somme, mûrie depuis longtemps, qui est enfin publiée. Avant même d’aborder le contenu de cette importante monographie, parcourir au préalable la copieuse bibliographie qui clôt l’ouvrage (p. 419-465) suffit à convaincre de l’érudition de son auteur. Les compétences linguistiques mobilisées ici sont nombreuses et variées. Tous les textes qui figurent dans le livre sont cités d’après l’original avant d’être rendus en suédois, un véritable atout qui rendra service au plus grand nombre.
L’Introduction (Inledning) débute de la manière suivante : «L’expression ‟Midgard brûle” résume le poème vieil-allemand Muspilli [prinnit mittilagart, vers 54], sa description de la destruction du monde. Ces mots s’appliquent également au mythe scandinave du Ragnarök. Après la grande bataille finale, le géant Surt embrase la terre et le monde entier se consume. Pourquoi aborder le mythe du Ragnarök dans un nouveau travail ? On pourrait penser que le thème est tellement épuisé qu’il n’y aurait plus de place pour de nouvelles approches» (p. 15). De fait, la question occupe le monde de la recherche depuis bien des décennies.
L’auteur montre que le mythe du Ragnarök est un motif que l’on retrouve à de nombreuses reprises dans les arts scandinaves du Moyen Âge à nos jours, par exemple au XIXe siècle en pleine ère romantique, chez les poètes Esaias Tegnér et Erik Gustaf Geijer, grands chantres de la Suède (p. 16-18). Le vieux mythe de la fin du monde, tel qu’il est dépeint dans les sources anciennes, a de quoi alimenter l’imaginaire des hommes versant dans l’art. Aussi Anders Hultgård retourne aux sources du récit eschatologique scandinave. Pour ce faire, il mène une enquête étymologique du mot Ragnarök (p. 18-22). Ce nom est composé de deux éléments. Le premier (ragna) est facile à comprendre : il s’agit du génitif pluriel de regin, «les dieux (qui décident)». Nous trouvons le second élément sous deux formes: røk ou rǫk (neutre pluriel) et røk(k)r (neutre singulier). Comme l’écrit l’auteur: «La forme rǫka déjà été considérée comme étant la plus ancienne et la plus correcte, mais c’est au contraire røkqui devrait être supposé. L’autre forme, røk(k)r, est un mot qui signifie ‟ténèbres, crépuscule” et, avec ragna, nous obtenons le sens ‟crépuscule des dieux”, dont Wagner, comme on le sait, fit usage pour son Götterdämmerung» (p. 18). Qu’en est-il de l’étymologie de la plus ancienne forme en ragna røk? «Selon l’interprétation habituelle, le terme signifie ‟le destin des dieux, la disparition des dieux”» (p. 19). Mais comme l’a récemment montré Haraldur Bernharðsson, ragna røk signifie peut-être «le renouveau des dieux»[1]. Anders Hultgård se rallie à la thèse du philologue islandais qui remet en question l’interprétation de ce mot. Le savant suédois poursuit donc son enquête en explorant les différentes attestations du mot røk que nous connaissons. On en retrouve les plus anciennes traces écrites dans le Gammelnorsk Homiliebok (L’Homéliaire norvégien) ainsi que dans l’Íslensk Hómilíubók (L’Homéliaire islandais). Dans ces recueils d’homélies, le mot røk «désigne pour le christianisme des évènements substantiels mythiques et a également un aspect rituel. Ces évènements sont simplement cités dans le sens où ils vont expliquer les différentes cérémonies censées être célébrées» (p. 21). L’étude du mot røk se poursuit avec l’examen des occurrences dans la tradition poétique (eddique et scaldique).
Le mythe du Ragnarök, comme on l’a dit plus haut, n’est pas un sujet d’étude neuf. Aussi, l’auteur est-il amené à en retracer l’histoire de la recherche. Les travaux du folkloriste danois Axel Olrik sur le récit eschatologique scandinave peuvent être considérés comme pionniers et décisifs (p. 23). L’importance de ses écrits sur le Ragnarök fut telle qu’ils ont longtemps influencé nombre de publications qui s’inscrivirent dans le sillage d’Olrik. Dans une perspective indo-européenne, Anders Hultgård évoque avec raison les considérables apports dus à l’indianiste suédois Stig Wikander et à l’historien des religions français Georges Dumézil, alors que ce dernier était lecteur de français à l’université d’Uppsala de 1931 à 1933 (p. 29-32). Leurs profondes connaissances de la tradition indienne ancienne leur ont permis de dresser des parallèles avec le mythe du Ragnarök. Comme le rappelle l’auteur, Dumézil a établi de proches parallèles à propos du dieu Baldr et du Ragnarök (p. 31). On relira ainsi avec intérêt «Le drame du monde : Baldr, Hödhr et Loki», Les Dieux des Germains (1959), troisième chapitre.
Toujours dans cette «esquisse de l’histoire de la recherche», Anders Hultgård aborde l’épineuse question de la dimension chrétienne que l’on pourrait retrouver dans le mythe du Ragnarök (p. 34-39). Cette lecture du récit eschatologique scandinave par le prisme du christianisme n’est pas nouvelle. L’un de ses plus ardents défenseurs était le philologue norvégien Sophus Bugge, qui pensait «qu’il n’existait pas de mythe cohérent du Ragnarök jusqu’à l’arrivée du christianisme» (p. 34). La question est en réalité plus complexe, comme l’a par exemple montré le philologue néerlandais Jan de Vries, qui soulignait que «le mythe du Ragnarök doit être né à l’époque où l’ancienne religion s’opposait à sa dissolution. L’inquiétude que cela a déclenché chez beaucoup a conduit à une tradition eschatologique cohérente désormais évoluée» (p. 34).
Parmi d’autres aspects que l’on peut relever en étudiant le mythe du Ragnarök, certains commentateurs de la mythologie scandinave ont cherché à démontrer que ce récit de destruction du monde pouvait être le «reflet de catastrophes naturelles», comme «la transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer 500 ans avant notre ère et pour laquelle le botaniste Rutger Sernander a emprunté le terme de fimbulvinter(norrois fimbulvetr) ‟grand hiver”» (p. 40). En langue française, on lira sur le fimbulvetr l’important article d’Anders Hultgård publié en 2009 dans Proxima Thulé.
Le mythe du Ragnarök pose un certain nombre de problèmes quant à son interprétation. Est-il influencé par la tradition chrétienne? Est-il «une expression d’une tradition indigène plus ancienne»? «Le mythe du Ragnarök ne circulait-il qu’en Norvège et en Islande, ou était-il également connu en Suède et au Danemark et dans le reste du monde germanique» (p. 41)? L’auteur se propose de répondre à toutes ces questions en étudiant la tradition scandinave en regard d’un certain nombre de traditions religieuses, notamment celles de l’Iran.
L’ouvrage d’Anders Hultgård est d’une richesse telle que rendre compte de l’intégralité de cette somme relèverait de l’exploit. Travail de longue haleine, fruit de nombreuses années de recherches menées en des contrées parfois éloignées dans le temps et l’espace, ce livre fera date, en ce qu’il s’inscrit pleinement dans la lignée des grandes monographies consacrées à la mythologie scandinave et plus largement à l’histoire des religions. On y trouvera maints éclairages sur le Ragnarök à l’aune de la mythologie comparée. Si cet ouvrage érudit est écrit en suédois, il est à espérer que paraisse un jour une version française de ce Midgard brûle, qui sera pour l’historien des religions de la plus grande utilité.
Mahdî Brecq
[1]Haraldur Bernharðsson, «Old Icelandic ragnarökand ragnarökkr», dans Verba Docenti. Studies in historical and Indo-European linguistics presented to Jay H. Jasanoff. Edited by Alan J. Nussbaum, Ann Arbor/New York, Beech Stave Press, 2007, p. 25-38.