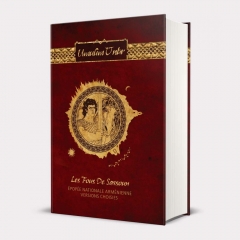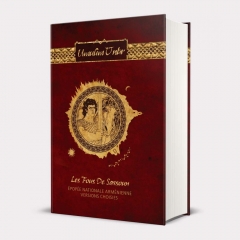 Karapet Melik-Ohandjanian, Les Fous de Sassoun, épopée nationale arménienne, 2015, Erevan, Edit Print, 721 p.
Karapet Melik-Ohandjanian, Les Fous de Sassoun, épopée nationale arménienne, 2015, Erevan, Edit Print, 721 p.
Les épopées arméniennes populaires, notamment celles concernant ceux qu’on a appelé les Fous de Sassoun – le plus illustre étant David de Sassoun – sont encore peu connues des spécialistes de la mythologie comparée, parmi lesquels se trouvent peu de personnes maîtrisant l’arménien. Aussi, venant des chercheurs francophones, ne peut-on lire que des études ponctuelles, notamment de Claude Steckx1, de Marcel Meulder2ou de moi-même3. Une seule étude, très brève, spécifiquement consacrée à ce cycle, est parue, à ma connaissance, en français4. On peut noter que le lectorat anglo-saxon est à peine mieux servi.
Pourtant, on disposait jusqu’ici de deux traductions du cycle, reposant sur deux versions différentes: celle de Frédéric Macler en 19335, et celle de Frédéric Feydit en 19646. L’une comme l’autre sont basées sur des versions synthétiques élaborées par des folkloristes arméniens à partir de plusieurs versions. Il est en effet assez rare de noter chez un seul conteur l’ensemble du cycle. Mais tandis que les récits caucasiens sur les Nartes sont maintenant bien connus et employés par les mythologues, grâce à l’action de sauvegarde et d’étude menée durant toute sa carrière par Georges Dumézil, l’épopée populaire arménienne reste, je l’ai dit, relativement méconnue et peu utilisée en mythologie.
Or il s’agit-là tout de même d’un corpus important, dont l’étude n’a jamais vraiment cessé en Arménie-même, et le présent volume nous offre un écho de ces travaux.
Les Fous de Sassoun nous propose en effet, en version bilingue arménien-français, un ensemble de neuf versions différentes et complètes du cycle, collectées entre 1873 et 1932, et sélectionnées par le folkloriste Karapet Melik-Ohandjanian (1893-1970). Neuf versions complètes, quand jusqu’ici nous n’en disposions en français que de deux. Il va donc sans dire que ce livre recèle un petit trésor, car il en va de l’épopée arménienne comme des autres épopées populaires: les variantes sont aussi nombreuses qu’il y a de conteurs, et chacune peut avoir son importance.
Prenons pour exemple le duel final entre David de Sassoun et son adversaire de toujours, le Mélik de Missir, ici correctement orthographié Msramélik. Dans les versions traduites par Macler ou Feydit, on voit le Msramélik se faire creuser une fosse et s’y enfouir sous un certain nombre de meules et de peaux de buffle, afin de se protéger du coup mortel de David. Or on découvre dans Les Fous de Sassoun une variante qui le montre s’enfouir non plus dans une fosse, mais sous un tas de cadavres collectés sur le champ de bataille. Cette variante, pour isolée qu’elle soit, doit tout autant faire sens que les autres.
La copieuse étude introductive de Karapet Melik-Ohandjanian, datant de 1964, est elle-même très utile, même si elle est parfois hardie. Son hypothèse voulant que le Grand et le Petit Mher ne soient que deux aspects d’une seule ancienne divinité, l’iranien Mithra, est séduisante: l’auteur note bien que si Mithra est né d’un rocher, la mère de Mher conçoit celui-ci de l’eau d’un fontaine jaillie d’un rocher. L’hypothèse est aussi assurée du point de vue étymologique. Pour l’auteur d’ailleurs, seul le Petit Mher, fils de David, aurait initialement existé.
Deux regrets viendront toutefois conclure ce compte rendu. Le premier concerne l’absence de relecture sérieuse de la version française, notamment concernant les textes de la préface et de l’introduction. Les coquilles sont nombreuses, et si la traductrice maîtrise le français, elle n’avait visiblement pas complètement le bagage culturel nécessaire pour un tel travail. Ainsi, le mythographe grec Évhémère est appelé «Éphémère» (p. 19), le latin mithraeum (sanctuaire de Mithra) est rendu par mithreum (p. 91), le grand historien arménien que la tradition érudite francophone connaît sous le nom de Moïse de Khorène, est ici systématiquement dénommé Movsès Khorenatsi ou simplement Khorenatsi, ce qui, il est vrai, est la forme la plus exacte, mais n’aide pas le non spécialiste de l’Arménie.
Le deuxième regret concerne la diffusion du livre. Bien qu’étant intégralement bilingue arménien-français, Les Fous de Sassoun n’est absolument pas diffusé en France. Pour se le procurer, il est donc nécessaire de le commander directement auprès de l’éditeur, à Erevan, éditeur heureusement doté d’un site ayant une interface en anglais.
Patrice Lajoye