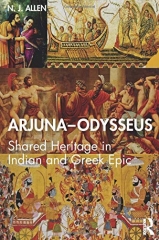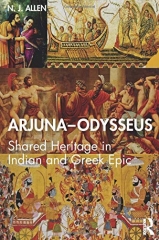 N. J. Allen, Arjuna-Odysseus. Shared Heritage in Indian and Greek Epic, 2020, Londres-New-York, Routledge, 350 p.
N. J. Allen, Arjuna-Odysseus. Shared Heritage in Indian and Greek Epic, 2020, Londres-New-York, Routledge, 350 p.
Le 21 mars dernier, l’un des membres de notre comité éditorial, Nick Allen, de l’université d’Oxford, reconnu pour son travail d’anthropologue, d’indianiste et de comparatiste, nous a quittés des suites d’une longue maladie. Avant qu’il n’en ait plus la possibilité, il a réuni, dans le présent ouvrage et en vingt-quatre chapitres, autant d’articles précédemment publiés et ici mis à jour – à l’exception du dernier, qui était inédit1. Cette somme constitue la synthèse de ses recherches concernant principalement les parallèles existant entre la grande épopée indienne du Mahābhārata et différents récits de la tradition grecque.
Dans l’introduction de ce recueil, l’auteur rappelle que même si l’origine commune, proto-indo-européenne, du sanskrit et du grec ancien est parfaitement acceptée, celle des traditions épiques portées par ces langues est moins reconnue. Les similarités qui apparaissent entre elles ont souvent été traitées comme autant de coïncidences relevant des universaux de l’imaginaire humain ou d’emprunts, dans un sens ou dans l’autre. Nick Allen pose alors les bases de son argumentation en faveur de la protohistoire commune des récits grecs et indiens. Il définit tout d’abord son champ de recherche, pour lever toute ambiguïté méthodologique, comme étant celui du comparatisme culturel indo-européen, car la notion de mythologie comparée – même si elle forme le cœur de son étude – peut être considérée comme trop réductrice, du fait qu’elle ne prend pas en compte certaines catégories de textes qui peuvent éclairer la littérature épique. De ce champ de recherche, il rappelle les grandes dates, des pionniers du XIXe siècle jusqu’à nos jours, en s’attardant plus particulièrement sur l’œuvre de Georges Dumézil et, plus précisément, sur le premier tome de son opus magnum, paru en 1968, Mythe et épopée, I : l’idéologie des trois fonctions des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. De même, il se penche sur Celtic Heritage, le livre séminal de Alwyn et Brinley Rees, qui esquissa l’idée de l’expansion du modèle trifonctionnel par l’adjonction de deux nouvelles catégories, chacune située aux extrémités de la série fonctionnelle. Enfin, Nick Allen développe l’objectif principal de ce livre : prouver la validité des études culturelles comparatives par le biais de l’omniprésence de l’héritage indo-européen dans les littératures grecques et indiennes.
Plutôt que de faire un examen de chaque chapitre dans leur ordre d’apparition, nous les analyserons thématiquement, selon quatre catégories : ceux portant sur la méthodologie du comparatisme, ceux comparant les aventures d’Ulysse et d’Arjuna – les héros principaux de l’Odyssée et du Mahābhārata, ceux s’attardant sur la mise en parallèle d’autres figures principales des deux épopées entre-elles et les études n’appartenant à aucun des autres groupes.
Les chapitres théoriques sont au nombre de deux. Le premier, intitulé «A starting point», est celui sur lequel s’ouvre l’ouvrage. Il présente et développe l’idée d’une quatrième fonction qui viendrait compléter le modèle trifonctionnel dumézilien, en prenant en compte tous les éléments, sociaux ou non, n’appartenant pas au cadre des trois fonctions. La démonstration de l’existence de cette quatrième fonction repose sur une base sociologique et ethnographique solide. Cependant, hormis plusieurs notes y faisant référence, cet article ne prend pas en compte les mises à jour que l’auteur lui-même a fait subir à sa théorie en plus de trente ans. C’est dommage car un tel article aurait pu être utile pour permettre à l’auteur de faire le bilan de cette théorie.
La seconde étude épistémologique («Dumézil and Dumont») forme le quinzième chapitre, qui est consacré à la comparaison des cultures indiennes et européennes dans l’œuvre de Georges Dumézil et celle de Louis Dumont. Nick Allen met tout d’abord en parallèle les méthodes respectives de ces deux chercheurs, avant d’utiliser les théories de Dumont pour argumenter l’extension et la clarification des idées de Dumézil et inversement. Pour cela, il se sert de sa théorie de la quatrième fonction comme d’un élément unificateur des visions des chercheurs qu’il compare.
La seconde thématique, celle de la comparaison des aventures d’Arjuna avec celles d’Ulysse, s’ouvre, dans le deuxième chapitre, par la mise en parallèle des cinq relations féminines qu’ont connu respectivement ces deux héros durant leurs aventures. À travers son analyse comparative de ces deux séries féminines, Nick Allen montre bien que celles-ci sont la transposition épique des cinq principales formes d’unions connues des cultures indo-européennes, qui se répartissent en une série pentadique quadrifonctionnelle qui peut même – dans le cas indien – se répartir spatialement, selon la symbolique des points cardinaux et du centre. Cette étude se voit prolongée et précisée dans le chapitre 6 («Crocodiles and Nymphs»), dans lequel l’auteur revient sur les rencontres féminines les moins matrimoniales d’Arjuna et Ulysse : la confrontation du premier avec cinq nymphes indiennes (apsares) transformées en crocodiles et les mésaventures du second avec les monstres femelles des détroits – Scylla, Charybde et les sirènes. L’auteur réussit à prouver qu’en dépit des différences initiales entre les deux épisodes, leurs similarités sont suffisantes pour envisager un héritage commun indo-européen. Dans l’étude suivante, «Homer’s simile», notre auteur montre les similarités entre l’arrivée d’Ulysse sur l’île de Schérie et la phase yogique du voyage d’Arjuna au paradis d’Indra. Dans les deux cas, le héros subit, volontairement ou non, des épreuves physiquement éprouvantes, dans lesquelles sont impliqués un ou plusieurs êtres surnaturels, avant qu’il(s) ne mette(nt) fin au calvaire du héros, pour le plus grand soulagement d’une collectivité anonyme qui fut angoissé par le sort de ce dernier. Le chapitre 5 («Yoga») reprend les aventures d’Ulysse et d’Arjuna comparées dans l’étude précédente et ajoute à ce dossier deux des plus anciens traités contenant des idées yogique pour essayer d’y identifier la part de l’héritage indo-européen dans l’émergence de cette pratique rituelle.Nick Allen en conclut que le proto-récit à l’origine des aventures d’Ulysse et d’Arjuna devait contenir un épisode en lien avec une pratique rituelle qui participa à l’émergence du yoga en Inde, tout en étant atténué et sécularisé dans la narration grecque. Dans le chapitre 4 («Hero and Horse»), partant d’une tradition obscure de transformation d’Ulysse en cheval au moment de sa mort, l’auteur montre que celle-ci a pour équivalent indien la grande proximité entre Arjuna et le cheval de l’aśvamedha, le sacrifice équin et confirmant de la royauté universelle indienne, tout en montrant que le double sacrifice expiatoire que doit faire Ulysse à la fin de l’Odyssée, se retrouve dans l’aśvamedha et dans le sacrifice propriatoire nécessaire à l’obtention des richesses que demande l’exécution somptuaire du premier.
Les comparaisons entre les autres figures des deux traditions sont tout aussi intéressantes et riches. Ainsi, dans le chapitre 7, notre auteur met en parallèle la rencontre entre Ulysse et son chien Argos, lors de son retour à Ithaque, avec celle de Bhīma – le brutal frère guerrier d’Arjuna – et le dieu-singe Hanumān, dont il est le demi-frère par son père divin, le dieu-vent Vāyu. Les actions préliminaires à l’épisode grec apparaissent également similaires au récit qui suit la rencontre avec Hanumān. Dans l’étude suivante, Nick Allen compare les rôles respectifs d’Athéna et de Durgā – deux déesses dont les identités respectives remontent (en partie du moins) à un prototype divin indo-européen2– dans l’Odyssée et le Mahābhārata, en les replaçant dans le contexte de leurs schémas narratifs respectifs, où le rôle d’Athéna est non seulement occupé par la déesse indienne, mais aussi par Arjuna et ses frères, ainsi que par le dieu Dharma déguisé. Dans le chapitre 9, l’auteur reprend le dossier de la mise en parallèle de Pénélope et de Draupadī3, les héroïnes royales des deux épopées. L’étude qui suit compare Bhīṣma, généralissime du mauvais camp du Mahābhārata à Sarpédon et Hector, deux meneurs du camp troyen de l’Iliade. Dans le chapitre 11, Nick Allen montre que les souverains divins qui se succèdent dans la théogonie hésiodique se reflètent dans la succession dynastique qui mène à la génération des héros du Mahābhārata; remettant par là même en cause l’origine exclusivement proche-orientale de ce mythème en Grèce. Dans «Yudhiṣṭhira and Agamemnon» (chapitre 16), il montre que la dispute du second avec Achille trouve comme répondant, dans le Mahābhārata, les querelles entre Yudhiṣṭhira – dont le rôle est similaire à celui d’Agamemnon en tant que meneur des «Bons» – Arjuna – principal champion de l’épopée indienne comme Achille pour la grecque – mais aussi, d’une part, celle entre Yudhiṣṭhira et Śalya, et, d’autre part, entre Bhīṣma et Karṇa. Dans l’étude suivante, «Kauravas and Suitors», l’auteur montre que le retour d’Ulysse à Ithaque ou, plus particulièrement, certains des épisodes qui y figurent correspondent à différents passages du Mahābhārata, comme si un amalgame de certains épisodes du proto-récit indo-européen s’était produit en Grèce.Dans «Gods descent to battlefield» (chapitre 19), Nick Allen rapproche la confrontation entre Hephaïstos et le Scamandre au livre 21 de l’Iliade et les circonstances qui y mènent de l’opposition entre Agni et Indra dans l’incendie d’une forêt et le massacre de ses habitants, dans le Mahābhārata. Dans le chapitre 23, il montre que le conflit entre le prêtre Chryses et le roi Agamemnon, dans l’Iliade, est l’équivalent de celui entre le brahmane Droṇa et le roi Drupada, dans le Mahābhārata. Enfin, le dernier chapitre, «Aśvatthāman and the wooden horse», reprend et complète, sous un angle uniquement épique, la comparaison entamée par Christian Rose entre Aśvatthāman, dernier champion du camp des «mauvais» et le Cheval de Troie4.
La troisième catégorie d’études, qui ne relèvent ni de la méthodologie, ni de la mise en parallèle «mytho-biographiques» à strictement parler, commence par le chapitre 12, qui n’est pas lié aux traditions épiques de la Grèce et de l’Inde. Il concerne les conceptions philosophiques partagées entre ces deux contrées et, en particulier, sur celle portant sur l’existence de cinq éléments dans ces traditions – à laquelle l’auteur ajoute celle de l’Iran. Selon lui, ces ensembles élémentaires pentadiques se distribuent selon une logique quadrifonctionnelle. Les chapitres 13 et 14 doivent se lire comme un tout. En effet, dans le premier, «Rings and rotations», Nick Allen montre que les éléments constitutifs de la représentation microcosmique bouddhiste du mandala se retrouvent en Grèce, à la fois, dans le passage de l’Odyssée où Ulysse doit affronter les monstres des détroits – les Sirènes, Scylla et Charybde – et dans la description du bouclier d’Achille dans l’Iliade. Or, justement, dans le second, «Achilles’ shield», l’auteur reprend l’analyse trifonctionnelle de la description de cet objet, par Atsuhiko Yoshida5, pour l’étendre à la quatrième fonction, tout en découvrant à l’intérieur de l’ensemble de troisième fonction formé par la séquence des activités pastorales qui y sont décrites une série d’éléments classés selon une logique quadrifonctionnelle. La double démonstration de ces chapitres nous semble là encore tout à fait pertinente. Cependant, le fait de voir, dans la description du bouclier, la scène du mariage et celle de la danse, comme étant des ajouts tardifs et non-fonctionnel alors qu’elles furent identifiées, par Yoshida, comme faisant partie respectivement des représentations de la première et de la troisième fonction sur ce bouclier, me semble être une question qui devrait être approfondie. Dans le chapitre 18 («Hanging over abyss») vient s’y ajouter le motif de «l’homme suspendu» présent dans ce passage de l’Odyssée, mais aussi dans deux passages non encore étudiés du Mahābhārata. Au terme de la comparaison, Nick Allen en vient à envisager une mise en parallèle plus large, comprenant également l’épisode des nymphes changées en crocodiles, celui de la roue de vie bouddhiste et du bouclier d’Achille, lui permettant de faire remonter ces six éléments à la combinaison de trois proto-récits: l’un dont le message philosophique était exprimé à travers la parabole d’un homme suspendu au-dessus du vide; un récit légendaire portant sur la conception des différents types de mariage; la description d’une image à portée cosmographique. Dans «Heroes and supercategories» (chapitre 20), Nick Allen propose de comprendre différents groupements de figures homériques et indiennes comme se conformant au schéma pentadique quadrifonctionnel.
En dehors des critiques déjà exprimées, le fait que cet ouvrage soit constitué du rassemblement de plusieurs articles qui, pour la plupart, ne sont ni inédits ni réécrits implique de nombreuses répétitions, en particulier dans les introductions de plusieurs textes, où l’auteur expose que l’origine commune des langues grecques et indiennes présuppose une proto-langue qui aurait été le support d’un proto-récit épique dont les constituant peuvent se deviner à travers la comparaison des traditions grecques et indiennes. Une telle précision est nécessaire dans le cadre d’un article, mais pas dans celui d’un ouvrage qui se veut l’exposé d’une œuvre de plus de trente ans. La place ainsi économisée aurait permis d’insérer, dans cet ouvrage, au moins une autre étude.
Cependant, nous ne jetterons pas la pierre à l’auteur, car nous comprenons bien que cela aurait été un effort supplémentaire et chronophage pour un chercheur toujours aussi actif et productif dans ses recherches, même au crépuscule de sa vie.
Et en dépit de ces quelques infimes bémols, nous avons là un ouvrage de premier plan, concernant l’étude des correspondances entre traditions grecques et indiennes épiques, le plus souvent dans un cadre quadrifonctionnel. C’est donc un magnifique chant du cygne qui vient couronner un intérêt de plus de trente ans de l’auteur pour ces sujets, un peu à la manière de ce qu’avait fait Dumézil dans son Mythe et Épopée.
Guillaume Oudaer
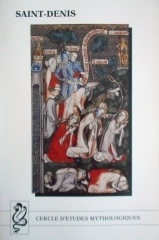 Mémoires du Cercle d’Études mythologiques, XXIX, 2019, 108 p.
Mémoires du Cercle d’Études mythologiques, XXIX, 2019, 108 p.