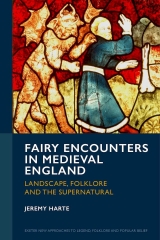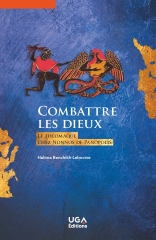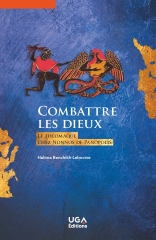 Halima Benchickh-Lehocine, Combattre les dieux. Le théomaque chez Nonnos de Panopolis, 2025, Grenoble, UGA éditions.
Halima Benchickh-Lehocine, Combattre les dieux. Le théomaque chez Nonnos de Panopolis, 2025, Grenoble, UGA éditions.
On connaît mieux en France Nonnos de Panopolis depuis l’édition héroïque des Dionysiaques (CUF 1976-2006) dirigée par Francis Vian, et celle du premier tome (chants I à VI) de la Paraphrase de l’Évangile selon Jean (CUF M. Ch. Fayant, 2025). L’œuvre de ce poète de l’Antiquité tardive demeure néanmoins difficile à maîtriser pour deux raisons principales:
– son volume considérable (les Dionysiaques comptent 48 chants, le double de l’Iliade, la Paraphrase en compte 21);
– la double postulation religieuse : comment le même poète a-t-il pu chanter tour à tour Dionysos et le Christ (ou inversement)? L’œuvre de Nonnos repose-t-elle sur une opposition, ou sur une unité syncrétique?
Giraudet a vu dans l’épopée nonnienne «une forme vide aux potentialités infinies». Pour Halima Benchick-Lehocine, il faut trouver une clé qui permette d’entrevoir l’unité si problématique de l’œuvre. Même si le terme de «comparatisme» (p. 15) est ici discutable, le premier choix de l’autrice paraît judicieux: les adversaires de Dionysos comme ceux de Jésus sont des gens qui «combattent contre un dieu», des théomaques.
Mais comment aborder cette recherche sans risquer la noyade dans l’immensité de l’œuvre? Cette fois encore, le choix était le bon: une étude précise et systématique du vocabulaire de la théomachie, d’abord dans l’ensemble de la littérature grecque, païenne et chrétienne, avant Nonnos, puis dans l’œuvre nonnienne. On peut ainsi esquisser le «portrait» des théomaques, qu’ils soient les adversaires de Dionysos ou ceux de Jésus, d’abord selon leur comportement en actes: hostilité, hybris, impiété, mépris de l’hospitalité, obstination; puis en discours: mensonges, insultes, menaces. Le dieu sait comment répondre à ces agressions: métamorphose, aveuglement, humiliation, mort… Cette mise en séries permet «d’entrevoir une véritable différence entre les Dionysiaques et la Paraphrase»: c’est que «dans l’Évangile l’offense est nécessaire» puisque Jésus doit être trahi par Judas et mis à mort (p. 204). Ce moment de l’étude m’a paru particulièrement important.
L’autrice aborde ensuite une comparaison plus riche, à mon sens, à partir du thème des «Géants» qui «fonctionnent comme des exemples archétypiques de figures violentes qui se dressent contre le divin» (p. 209): pour la gigantomachie du chant 48 des Dionysiaques, Nonnos «réécrit le mythe pour faire de Dionysos le dieu principal» (p. 207). Caractéristique de ce «club des Géants» (l’expression est plaisante), on retrouverait la nature serpentine chez les personnages Juifs, dépeints de façon beaucoup plus négative que chez Jean, et qui sont liés à la Terre et fils de Satan. Cependant, la référence au serpent-diable et aux Géants bibliques reste implicite chez Nonnos, d’où le concept de «crypto-Géants» (p. 217). Intéressante est l’analyse des rapports entre Géants mythiques de la Grèce et les êtres antédiluviens de la Bible, ou le chasseur Nimrod et d’autres personnages de taille extraordinaire comme Goliath: «larcin» mythologique fait aux Grecs, ou l’inverse? Philon et les Pères de l’Église se sont posé la question. Le comparatiste, s’il est autorisé à parler de la Bible, est en droit de se la poser, à condition bien sûr de renouveler les termes et la méthode de l’enquête.
L’autrice envisage aussi les querelles entre divinités, par exemple l’éris entre Dionysos et Poséidon pour la nymphe Beroé (et sa cité, Béryté) (Dionysiaques, 43) qui fait écho à la dispute de Poséidon avec Hélios pour Corinthe, et à celle, plus fameuse encore, du même Poséidon et d’Athéna pour Athènes. Plus curieuse est la rivalité de Nonnos avec son «père» en poésie, le grand Homère, qu’il entend dépasser en narrant la guerre de Dionysos contre les Indiens, autrement grandiose que celle de Troie.
La lecture de cet ouvrage, ne le cachons pas, est difficile. Il s’agit essentiellement d’une étude stylistique et rhétorique souvent précise et très technique, qui contraindra parfois le non-spécialiste à consulter un lexique, et tout lecteur à se concentrer sur certaines formules d’abord énigmatiques: «l’hypallage tirant sur la métonymie» (p. 59). Ci n’entrez pas si vous ne maîtrisez pas le sens des «formules prodramatiques», de l’hypotypose, de l’épiphore, du «polyptote associé à l’antithèse», des «actes promissifs».
Cette difficulté est aggravée par des négligences d’expression, par exemple les pléonasmes. Ainsi Agavé est décrite sous les traits d’un «félin carnivore» (p. 186): une lionne, certes, mais, que je sache, tous les félins sont carnivores, et souvent même carnassiers… On est parfois gêné par des constructions fautives: «l’instance poétique l’enjoint à faire…» au lieu de «lui enjoint de faire…» (p. 253).
Combattre les dieux ne s’intéresse guère aux contextes historiques de la création nonnienne, et d’aucune façon aux cultures et traditions poétiques étrangères à ce couple inattendu «Homère-Évangile de Jean».
Pierre Sauzeau