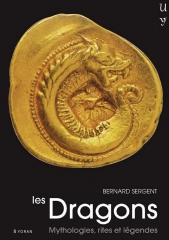Dominique Briquel, À la Recherche d’une mythologie indo-européenne, 2021, Città, Agorà &Co.
Dominique Briquel, À la Recherche d’une mythologie indo-européenne, 2021, Città, Agorà &Co.
Dominique Briquel est un spécialiste de l’étude des Étrusques et des premiers temps de Rome, mais c’est également un héritier de la pensée de Georges Dumézil et nombre de ses travaux portent sur la comparaison entre le matériel mythologique religieux des Romains et des Grecs et celui des autres cultures indo-européennes. C’est là l’objet du présent recueil qui rassemble des études parfois inédites ou difficiles d’accès, les rendant ainsi disponibles à un plus large public.
Après une préface de John Scheid, qui place l’auteur dans la lignée de G. Dumézil, l’auteur introduit cette compilation en explicitant son classement, en trois parties, des vingt-et-un articles qui la composent. Les deux premières parties se placent directement dans le prolongement de deux thématiques fortes appréciées de G. Dumézil : la première, « Les combats des dieux » porte sur le mythème de la bataille eschatologique ou Bataille finale1, tandis que la seconde, « Le feu dans l’eau » concerne ce concept unissant paradoxalement ces deux éléments. Enfin, la troisième partie, « Figures divines et héroïques », comme son titre l’indique, s’attache à l’analyse comparative de celles-ci voire au prolongement ou à la correction d’études de G. Dumézil. Cependant, comme il le signale dans son introduction, D. Briquel s’est démarqué de son prédécesseur en ne suivant pas forcément la même méthode d’analyse ou en abordant d’autres thématiques.
La première partie de cet ouvrage s’ouvre d’abord sur une présentation du mythème de la Bataille finale et de son historiographie depuis les premiers travaux de G. Dumézil jusqu’aux derniers parus sur la question, en passant par l’évocation des sujets de ses différents articles portant sur cette question et rassemblés dans cette partie. Dans « Mahābhārata, crépuscule des dieux et mythe de Prométhée », D. Briquel met en parallèle les acteurs de ce mythe grec aux résultats de la comparaison faite par G. Dumézil entre les Indiens Dhṛtarāṣṭra et Vidura et les Scandinaves Hödr et Baldr. La succession de la royauté cosmique grecque entre Ouranos, Cronos et Zeus est comparée aux trois générations souveraines incarnées par Bhīṣma, Pāṇḍu et Yudiṣṭhira, reflets épiques respectifs des dieux Dyaus, Varuṇa et Mitra est le sujet de « La théogonie d’Hésiode. Essaie de comparaison indo-européenne », où d’autres équivalents de Dhṛtarāṣṭra et Vidura sont les Cyclopes et les Hécatonchires. « Jupiter, Saturne et le Capitole. Essai de comparaison indo-européenne » voit l’identification de ce mythème de la souveraineté cosmique au sein de la tradition romaine. Le caractère trifonctionnel des antagonistes disputant la souveraineté cosmique au fils de Cronos est le sujet de l’étude suivante (« Les adversaires de Zeus : Titans, Géants, Typhée et Prométhée »). Dans l’article suivant, notre auteur analyse « La naissance de la République romaine comme avènement d’un monde parfait : arrière-plan eschatologique du récit traditionnel ». Il s’agit là du prototype de l’ouvrage où il développe la thèse et les arguments présentés ici2. Un doublet de cette version romaine de la Bataille finale fut également identifié par D. Briquel comme étant la prise de Rome par les Gaulois3 . Il revient sur un aspect de ce dossier dans « La prise de Rome par les Gaulois comme prolongement de la Bataille finale. Un complément : la question des auxiliaires de la souveraineté ». Une anecdote du même récit romain est mise en parallèle d’un célèbre passage du Mahābhārata dans « Le plaustrum de Lucius Albinus et le char d’Arjuna : faut-il envisager un élément hérité derrière la Bhagavad Gita ? ». Enfin, cette partie se conclut par « L’histoire de Coriolan et la comparaison indo-européenne » où notre auteur revient sur la comparaison de Lucien Gerschel, reprise par G. Dumézil, concernant le caractère trifonctionnel des ambassades envoyées à Coriolan. Il y montre que cette analyse n’est pas valable, mais il vient en confirmer d’autres concernant ce héros romain et en proposer de nouvelles. En outre, il montre bien le parallélisme entre Coriolan et un autre héros de la geste romaine, Camille. Sachant que ce dernier est inscrit dans un schéma narratif de type Bataille finale, D. Briquel en déduit que Coriolan doit aussi obéir au même mythème.
Dans un deuxième temps, Dominique Briquel explore la thématique du « Feu dans l’Eau ». Ce concept indo-européen désigne une force, à la fois ignée et aquatique, de nature ordalique et liée à la notion de souveraineté, dont l’importance fut découverte par G. Dumézil, à partir d’une triple comparaison4. Dans celle-ci, l’un des récits étudiés était celui de l’éruption du lac Albain, dont la maîtrise des eaux avait permis aux Romains de prendre la ville étrusque de Véies. La première étude présentée ici (« Sur un passage d’Hérodote : prise de Babylone et prise de Véies ») est un prolongement et une rectification des conclusions de Dumézil concernant cette histoire. En effet, D. Briquel montre bien, par comparaison avec le récit d’Hérodote sur la prise de Babylone par Cyrus, que l’épisode du lac Albain ne doit pas être seulement vu comme une correction de l’irrégularité de la désignation des magistrats romains, puisque la maîtrise de ces eaux, similaire à celle du fleuve Gyndès par Cyrus, est le signe de la victoire future de Rome sur sa rivale étrusque. L’anecdote perse rapportée par Hérodote est comprise par lui comme un signe d’hybris de la part de Cyrus, ce qui ne devait pas être le cas dans les mentalités iraniennes. Le même type de distorsion est aussi le sujet de « The Punishment of the Hellespont by Xerxes : Perception of religious behavior of the enemy in conflict situations », où Hérodote considère que la flagellation des eaux de l’Hellespont par Xerxès, pour les punir d’avoir détruit un pont traversant le détroit, est là aussi un acte d’hybris, alors qu’il s’agit de la même logique iranienne de maîtrise souveraine des forces du Feu dans l’Eau, dont le souverain est le dépositaire légitime. Cependant, même si cette conception du rapport entre la royauté et les eaux vives n’était pas comprise des Grecs, ceux-ci ont conservé d’autres représentations du Feu dans l’Eau. Ainsi, dans « Vieux de la mer grecs et Descendants des eaux indo-européens », D. Briquel montre que les figures appelées « Vieux de la mer », comme Nérée ou Protée, sont des incarnations du Feu dans l’Eau qui doivent être maîtrisées par le héros pour obtenir la vérité qu’ils recherchent. Celle-ci étant dérivé de l’office judiciaire du roi en tant que diseur de vérité. De même, il présente, dans « La comparaison indo-européenne dans le domaine grec : l’exemple de Poséidon », ce dieu comme étant aussi, en partie, une incarnation du caractère ordalique du Feu dans l’Eau, dans les conflits – où il est toujours perdant – qu’il a avec d’autres divinités pour la possession tel ou tel territoire, mais également dans d’autres aspects de sa personnalité : « ébranleur du sol », lien avec le cheval et la puissance fécondante, caractère malcommode du dieu. Retour à Rome avec « Tarquin l’Ancien et le dieu Vulcain » où l’auteur nous montre que ce dieu préside à une utilisation purement guerrière du Feu dans l’Eau par le monarque étrusque, tout en rappelant les liens de cette divinité avec l’aspect souverain de ce concept, en particulier dans la légende primitive de Romulus. Les deux études suivantes concernent une forme alternative et matérielle du Feu dans l’Eau : celle d’un trésor aurique ayant une origine et/ou un réceptacle aquatique. Ainsi, dans « La question des biens des Tarquins : blé du Tibre et or du Rhin », il montre que l’équivalent latin de cette forme germanique du Feu dans l’Eau qu’est le trésor des Nibelungen sont les biens frumentaires de la dynastie étrusque déchue qui furent précipités dans le fleuve romain, permettant ainsi l’émergence de l’Île Tibérine. « Le trésor du roi Décébale : à la recherche de représentations religieuses des anciens Daces (à propos de Dion Cassius, 68, 14, 3) » tente de montrer que la tentative de dissimulation aquatique de ses biens par le dernier roi des Daces devait répondre à des conceptions identiques sur le lien entre souveraineté, trésor royal et eaux d’un fleuve. Enfin, « Le combat de Jacob contre Dieu et le schème indo-européen du passage du fleuve » est la dernière étude concernant cette partie. Elle nous montre que cette victoire de Jacob sur les bords du Jaboq, fondatrice de la future souveraineté territoriale de sa descendance, est similaire aux affrontements ordaliques avec la divinité incarnant le Feu dans l’Eau. Elle pose aussi la question d’un héritage de certains motifs ou mythèmes indo-européens au sein de la tradition biblique.
Le dernier tiers de cet ouvrage concerne diverses divinités ou héros. Il s’ouvre là encore sur une introduction replaçant chacun de ces articles dans leur contexte historiographique. Le premier, « Remarques sur Quirinus », tend à clarifier la place paradoxale de ce dieu au sein du panthéon romain : c’est un dieu de troisième fonction, mais en tant que dieu des citoyens romains, il s’écarte de l’aspect fécond de F3 et a acquis de la sorte des aspects appartenant aux deux autres fonctions qui brouillent la personnalité de ce dieu. Dans « Some Remarks About the Greek God Hermes », notre auteur voit dans ce dieu un autre équivalent hellénique – après Prométhée et son frère et les deux séries de triplets monstrueux d’Ouranos et de Gaia – des deux divinités auxiliaires de la souveraineté, au niveau théologique cette fois-ci. « Note sur les calendes et les ides » se penche sur les rapports calendaires et lunaires de Junon et de Diane dont l’action est ici considérée comme complémentaire. C’est encore des relations existant entre ces deux déesses dont il s’agit dans « Lucrèce et Clélie, Junon et Diane, deux visions du féminin à Rome », mais, cette fois-ci, l’analyse, plus globale, passe par celle des deux héroïnes suscitées, qui semblent être les transpositions héroïques de ces deux formes latines de la déesse trivalente indo-européenne ; tout en faisant un sort au passage à une autre hypothèse de Dumézil, celle de l’identification de Diane appartenant au genre des dieux cadres indo-européen. Cet ouvrage se referme sur une étude sur « Hercule et Cacus : remarques comparatives sur un mythe romain », où la mise en parallèle de ce récit avec d’autres traditions indo-européennes permet à l’auteur de l’identifier comme analogue au mythème de la récupération divine du bétail volé par un être démoniaque.
C’est là un recueil de première importance que tout bon mythologue indo-européaniste doit posséder dans sa collection. Cependant, deux bémols doivent être soulevés. Tout d’abord, des coquilles subsistent par endroits et elles sont parfois regrettables, comme celles du tableau page 164. Ensuite, nombre d’articles anciens auraient mérité une mise à jour bibliographique plus approfondie qui dépasse le cadre des introductions des trois parties. Il n’en reste pas moins que ces critiques sont mineures par rapport à la qualité générale de cet ouvrage.
Guillaume Oudaer
1Celle-ci voit s’affronter les représentants de la société trifonctionnelle aux incarnations des forces qui lui sont extérieures. Sur ce mythème, voir, en dernier lieu, P. et A. Sauzeau, La Bataille finale, Mythes et épopées des derniers temps dans les traditions indo-européennes, 2017, Paris, L’Harmattan.
2D. Briquel, Mythe et révolution. La fabrication d’un récit. La naissance de la République à Rome, 2007, Bruxelles, Latomus.
3C’est le sujet de son livre La Prise de Rome par les Gaulois. Lecture mythique d’un événement historique, 2008, Paris, Presse Universitaire Paris-Sorbonne.
4Il s’agit de la partie intitulée « La saison des rivières », in G. Dumézil, Mythe et épopée, III, Histoires romaines, 1973, Paris, Gallimard.