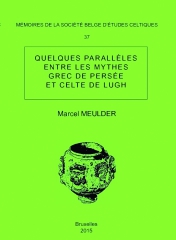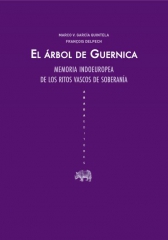Tetewatte et les Lupercales
Bernard Sergent*
* CNRS - Paris
Abstract: A Hittite ritual contains elements that recall those known from the Roman ritual of Lupercalia. The Hittite ritual seems to come from the Hatti, a non Indo-European population. In other words, we need to envisage a European pre-Indo-European legacy. Moreover, these rituals, which involve a pair of wolves, appear to be adaptations of an earlier ritual based on the bear. Here we glimpse how material dating back to the Paleolithic was revised in (neolithic?) Europe. It is this revision that was transmitted to the Indo-European-speaking populations.
Keywords: Wolf, Lupercalia, Tetewatte, Carnival, bears, ritual racing, Hatti, Indo-Europeans.
Résumé: Un rituel hittite présente des éléments qui rappellent ceux connus dans un rituel romain, les Lupercales. Ce rituel hittite paraît provenir des Hatti, population non indo-européenne. C’est dès lors un héritage européen pré-indo-européen qu’il faut envisager. De plus, ces rites où intervient un couple de loups paraissent adapter un rituel antérieur fondé sur l’ours. On entrevoit ici comment un matériel remontant au paléolithique a été revu en Europe (néolithique ?), et c’est cette révision qui a été transmise à des populations de langue indo-européenne.
Mots clés : Loup, Lupercales, Tetewate, Carnaval, ours, course rituelle, Hatti, Indo-Européens.
Télécharger le fichier en pdf / download in pdf: Sergent.pdf
Cité par / quoted by:
Alessandro Testa, « Ritual zoomorphism in medieval and modern European folklore : some sceptical remarks on a possible connection with a hypothetical Eurasian shamanism », Religio, XXV-1, 2017, p. 3-24.
Alain Meurant, « Réflexions sur le nom et le statut de Faustulus, père nourricier de Romulus et Rémus », Babelao, 10-11, 2022, p. 579-593.
Des points communs entre l’Anatolie du IIe millénaire et Rome ont été signalés un certain nombre de fois par les auteurs 1. Lorsque le matériel est proprement hittite, il est possible de parler d’héritage partagé, puisque le hittite appartient à la branche anatolienne des langues indo-européennes, famille à laquelle le latin appartient également. Mais il arrive que les choses soient moins simples, et c’est le cas avec la comparaison que je vais examiner ici 2.
Tetewatte est une déesse souvent nommée dans les textes hittites, sous des formes variées3, et néanmoins mal connue, car les mentions figurent généralement dans des énumérations divines, sans préciser en rien la fonction de la déesse 4. Mais une tablette importante, KBo XXIII 97, et sa copie en KUB VII 19, fournissent une description de la fête consacrée à cette déesse 5. En 1992, MmeF. Pecchioli Daddi en a fourni une traduction, que – ne lisant pas le hittite – je retraduis ici de l’italien :
« Mais quand l’”homme loup” [a pris ?] la viande hulhuli[ ] de porc, il la donne au prêtre de Tetewatte et le prêtre de Tetewatte la pose sur l’autel devant la déesse. Puis deux “hommes loups” dansent devant la déesse ; les “prostituées” aussi dansent devant (la déesse). La “grande des prostituées” (et) la prêtresse de Tetewatte, après avoir couru jusque devant, poursuivent la danse. [Mais] quand [...], ils achèvent la danse. Alors une vierge de Tetewatte tient levé le vêtement rouge avec [...] - sur le vêtement rouge il y a [...] - et, après (avoir) couru, derrière [...] et la prêtresse de Tetewatte, la “grande des prostituées” [et] les prostituées s’en vont. Devant elles (ont) cour(u) deux “hommes loups” et devant elles ils évacuent ; et eux [...] arrivent jusqu’au KI.LAM et à droite (?) [...] sur la route du retour eux de nouveau ... [...] (passage de chant en hatti). Quand alors ils ar[rivent] à la porte [...] la corne souffle [...] et au “grand des attachés au palais” [...] le “grand des attachés au palais” [...] la prêtresse de Tetewatte […] 6. »
Retenons alors les éléments de ce court dossier, et passons à Rome.
Le 15 février y était le jour d’une fête célèbre, les Lupercales7. Les personnages principaux en étaient les Luperci, dits respectivement Quinctialeset Fabiani, et que le mythe relie à Romulus et Remus. C’est d’ailleurs dans sa Vie de Romulusque Plutarque fournit une description du rite :
« Ils [les Luperques, sans doute] égorgent des chèvres, puis on leur amène deux jeunes garçons de famille noble : les uns leur touchent le front avec un couteau ensanglanté, et d’autres le leur essuient aussitôt en le frottant avec de la laine imbibée de lait. Une fois essuyés, il faut que ces garçons se mettent à rire. Ensuite, ils découpent les peaux de chèvres en lanières et courent à travers la ville, nus avec un simple pagne, et frappent avec ces lanières quiconque se trouve sur leur chemin. Les femmes en âge d’être mères n’évitent pas leurs coups, persuadés qu’ils contribuent à les rendre fécondes et à les faire accoucher heureusement. Une particularité de cette fête, c’est que les Luperques y sacrifient aussi un chien 8. »
À côté de ce texte essentiel, d’autres éléments, pris à différents auteurs, apparaîtront dans la discussion qui suit.
Récitatif :
a) Quelque soit la formation, fort discutée, du nom des Luperci, les auteurs s’accordent à voir dans sa première partie le nom duloup. Plutarque assure que la course des deux jeunes gens part de l’endroit, appelé le Lupercal, où Romulus fut exposé 9– et allaité par une louve. L’auteur donne d’ailleurs le « nom grec » de la fête, les Lukaia, « fête des loups » 10.
b) La dualité est affirmée de manière récurrente : il y a deux groupes de Luperques, deux jeunes nobles, et le rite imite les courses de Romulus et Remus 11.
c) L’origine (évidemment mythique) du rite de flagellation est fournie par Ovide 12 : après l’enlèvement des Sabines, les dieux frappent Rome d’une stérilité qui s’éternise. Hommes et femmes se rendent alors dans un bois consacré à Junon pour la prier, et ils entendent sa réponse à travers les arbres : « Qu’un bouc sacré pénètre les femmes d’Italie ! » Grâce à un devin étrusque, le risque de bestialité est écarté au profit de la flagellation : ce sont les lanières en peau de bouc qui « pénétreront » le dos des femmes.
Il est possible alors de se livrer à une comparaison, presque trait pour trait, entre la fête de Tetewatte et les Lupercales.
a) L’une et l’autre fêtes sont caractérisées par des hommes loups : le texte hittite le dit explicitement et le répète ; les Luperques sont « loups » par leur nom, et mythiquement parce qu’ils prolongent les courses des jumeaux élevés par la louve. On ignore l’accoutrement de ces « hommes loups » du rite hittite. Les Luperques sont nus, avec seulement une peau de chèvre sur les hanches, figurant par là des esprits de la nature 13 ;
b) à la dualité affirmée et récurrente dans le rite des Lupercales répond la dualité des « hommes loups » du rite hittite : le texte en mentionne d’abord un, puis il parle de deux, jusqu’à la fin du rituel ;
c) le rituel commence par un sacrifice : il s’agit d’un porc dans le rituel hittite, d’un bouc 14, dont la peau fournit les lanières, lors des Lupercales ;
d) les intervenants rituels mentionnés avec les hommes-loups et le prêtre et la prêtresse de Tetewatte sont les prostituées et d’abord leur représentante à toute, la « grande des prostituées ». Chez les Hittites, comme chez d’autres populations du Proche-Orient, quoiqu’on aie pu penser moralement de la prostitution, les prostituées étaient intégrées à des rituels, et y exprimaient la fécondité15. Dès lors, faire intervenir les prostituées dans le rituel de Tetewatte ou flageller les femmes pour les rendre fécondes sont deux modalités d’une même finalité : agir sur la fertilité humaine. Les Lupercales ont d’ailleurs elles-mêmes un lien, mythique, avec la prostitution : le départ de la course, le Lupercal, était la grotte où la louve avait allaité les jumeaux, et ceux-ci furent ensuite recueillis par Faustulus (« Petit Faunus »), dont l’épouse Acca Larentia est désignée dans la tradition comme une prostituée. Si l’on songe qu’en latin, lupasignifie à la fois « louve » et « prostituée », on voit, d’une part, que la mère adoptive animale et la mère adoptive humaine sont équivalentes, et d’autre part, qu’une prostituée joue un rôle aux origines de la ville de Rome et du rite des Lupercales ;
e) il est abondamment question de courses dans le texte hittite, et ce sont en particulier les hommes-loups qui courent. L’acte le plus spectaculaire des Lupercales est la course fécondante des Luperques autour du Palatin ; en revanche les danses mentionnées dans le document hittite, et d’ailleurs figurant dans la plupart des rituels hittites, sont sans parallèle romain (connu) ;
f) dans le rituel romain, les Luperques poursuivent les gens, en particulier les femmes, pour les fouetter ; dans le rituel du texte hittite, les hommes-loups précèdent le cortège féminin, évacuant apparemment tout ce qui pourrait se trouver sur son passage : il y a donc une véritable inversion entre un rite et l’autre ;
g) le passage concernant le vêtement rouge qu’élève une vierge est malheureusement très lacunaire. En tout cas, les Lupercales, dans le récit de Plutarque, comprennent également du rouge, et qu’on « élève » : il s’agit du sang des chèvres sacrifiées, dont on frotte le front des deux jeunes patriciens avec le couteau même du sacrifice 16. Curieusement, il est ensuite essuyé avec un tampon imbibé de lait : symbole de lactation, donc de fécondité, et le vêtement rouge du rituel hittite est brandi par une vierge, laquelle est une « réserve de fécondité » 17. Ce « vêtement rouge » qu’on élève doit aussi être comparé à un élément important des Lupercales : notre mois de février tire son nom de l’utilisation durant cette fête d’un objet, lefebruum: c’était, selon Servius, la peau du bouc sacrifié 18, laquelle devait être sanguinolente, et sans doute devait-il arriver qu’elle soit brandie par les Luperques ;
h) le roi est indirectement impliqué dans la fête par la mention du [...]grand des attachés au palais [...]. Les Luperques poursuivent par leur rite à la fois la naissance et les début du premier roi, Romulus, et les suites de l’enlèvement des Sabines, réalisé alors que Romulus était seul roi de Rome. Plus que cela, G. Dumézil, rappelant la curieuse occasion saisie par César pour se faire proposer la couronne par Antoine luperque pendant la course même, à laquelle il assistait dûment19, et le rajout par le même aux deux catégories de Luperques d’une troisième, les Luperci Julii 20, pointe un sens royal, largement oublié, des Lupercales21 ;
i) les Lupercales, au 15 février, sont une fête de liquidation des miasmes de l’hiver et un rite de préparation de l’avenir, par les flagellations fécondatrices des femmes. Ces significations sont en gros celles qu’on discerne à la fête hittite : les danses, les courses, paraissent avoir une fonction purificatrice, tandis que l’intervention des prostituées est fécondante ;
j) enfin – étant admis que la sonnerie de cor n’a pas de parallèle romain, et le sacrifice de chien pas de parallèle hittite – on doit souligner que le peu qu’on sait de Tetewatte s’accorde avec Junon – la déesse qui a ordonné le rite de fécondité romain. En effet, cette déesse recevait des offrandes de manière mensuelle, à l’occasion de la EZEN.ITU 22. Or, Junon, sous l’épiclèse de Covella, recevait également des offrandes mensuelles, aux calendes de chaque mois, en compagnie de Janus, ce qui lui valut l’autre épiclèse deKalendaris 23.
Comment expliquer cette ressemblance entre une fête hittite et une fête romaine ?
Avant tout, il faut souligner la difficulté que constitue le fait que le nom de la déesse est hatti, que sa fête contient un chant en hatti, et que donc tout cela fait partie de l’immense matériel d’origine hatti qu’adoptèrent les Hittites. Le hatti est une langue non indo-européenne, et cela ne facilite pas son déchiffrement24.
Cela n’oriente pas vers la notion d’un « héritage indo-européen ».
On peut alors envisager deux types d’explication :
a) Un premier type d’explication envisagerait une origine anatolienne de la fête romaine. La direction supposée se fonde sur la chronologie, la fête hittite appartenant au IIemillénaire, et la fête romaine n’étant, par la force des choses, pas attestée avant le Ier. Mais les voies de communication entre l’Anatolie centrale et le Latium sont obscures, et on hésite à employer les Étrusques comme intermédiaires, même si ceux-ci parlent un « luwi dialectal », selon la formule de F. Woodhuizen 25, et si un devin étrusque joue un rôle dans la mise en place des Lupercales. Les Tyrsènes étaient des riverains du nord-est de la mer Égée, et non – à notre connaissance – des continentaux de l’Anatolie centrale.
b) Un second type d’explication poserait comme hypothèse que les Romains, d’un côté, les Hittites, de l’autre, auraient hérité d’une fête d’origine non indo-européenne.
Je pense qu’il s’agit bien de cela, car on a de bonnes raisons de voir en les Lupercales une fête lointainement d’origine non indo-européenne.
À plusieurs reprises, les auteurs qui sont spécialistes de la fête de l’ours pyrénéenne ont souligné les ressemblances entre cette fête et les Lupercales. Elles se ressemblent assurément beaucoup, avec pour seule différence que ce qui est loup à Rome est ours dans ces fêtes. Mais là aussi il y a course, poursuite des femmes par les ours, mâchurage à la place des coups de fouet, tout cela dans un même but (fécondant), et en des dates très proches (premiers jours de février). Je renvoie aux études sur ce sujet 26, et je note tout ce suite un point essentiel : les fêtes pyrénéennes sont la modalité ouest-européenne d’un rituel de capture (ou d’élevage) de l’ours puis de son sacrifice (ou, parfois, de sa libération) qui s’atteste à travers tout l’hémisphère nord, en Sibérie, à Hokkaido (les Aïnu) et en Amérique du Nord 27.
En fonction de fond « ursin » des rituels de fin d’hiver eurasiens, ici ou là les rites présentent des substituts à l’ours : ce peut être, en France et Espagne, le Fou 28, à Bielsa en Aragon les personnages appelés Trangas 29, à Trèves (Gard) le Petassou 30… – Dans cette perspective, les Lupercales sont très exactement une ancienne fête de l’ours dans laquelle le loup a été substitué à l’ours.
Tel est alors l’intérêt de la comparaison ici opérée : elle suggère que la substitution du loup à l’ours ne s’est pas opérée dans la préhistoire de Rome, mais dans la préhistoire européenne, et les Romains d’une part, les Hatti d’autre part, ont été les héritiers de cette modification.
Bien sûr, cette fête a été ensuite intégrée dans le matériel héortologique indo-européen, l’Anatolie ne montre que le début du processus, tandis qu’à Rome la fusion s’est faite également dans la préhistoire – mais je n’ai pas à écrire cette histoire-ci, qui m’amènerait à reprendre le dossier traité par Dumézil en 1929, dans Le Problème des Centaures 31, d’ailleurs critiqué ensuite par lui-même, et donc à le récrire entièrement, à la lumière des nouvelles découvertes. Car, si l’on me suit, le rite carnavalesque s’est fait avec l’ours bien avant que de d’avoir été célébré avec les loups ou les centaures. Raconter tout cela est un bien vaste programme.
Alföldi, Andreas, 1974 : Die Struktur des voretruskischen Römerstaates, Heidelberg, Winter.
Altheim, Franz, 1938 : A History of Roman religion,Londres, Methuen.
Alp, Sedat, 1947 : « La désignation du Lituusen hittite », Journal of Cuneiform Studies,1, 164-175.
Bader, Françoise, « Animaux de nuit » II, Studia indo-europaea, 3, 171-193.
Blaive, Frédéric, 1999 : « Deux fêtes romaines : remarques sur les Equirria, notes sur les Lupercales », Ollodagos, 12, 301-308.
Bömer, Franz, 1958 : Die Fasten, Heidelberg, 2 t., Universitätsverlag.
Bosch, Robert, 2013 : Fêtes de l’ours en Vallespir, photographie de Noël Hautemanière, Canet, Trabulaire.
Coussée, Bernard, 1994 : « L’ancien carnaval de Saint-Pol-sur-Ternoise », Bulletin de la Société de Mythologie française, 173, 41-47.
Detienne, Marcel, 1972 : Les Jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, Paris, Gallimard.
Dioszegi, Vilmos, 1968 :Popular Beliefs and Folklore Tradition in Siberia,La Haye, Mouton.
Dumézil, Georges, 1929 : Le Problème des Centaures, étude de mythologie comparée indo-européenne, Paris, Geuthner.
– 1954 : « Meretriceset Virginesdans quelques légendes politiques de Rome et des peuples celtiques », Ogam, 6, 3-8.
– 1966 : La Religion romaine archaïque, Paris, Payot.
– 1983 : La Courtisane et les seigneurs colorés. Esquisses de mythologie,Paris, Gallimard.
Eliade, Mircea, 1968 : Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Paris, Payot (rééd. Payot-Rivages, 2015).
Frazer, James George, 1929 : The Fasti of Ovid,Londres, Macmillan.
Freu, Jacques, 1997 : « L’origine des Indo-Européens d’Anatolie et du “peuple hittite” », Ollodagos, 10, 249-331.
Gonet, Hatice, 1981 : « Remarques sur un geste du roi hittite lors des fêtes agraires », HetheticaIV, 79-94.
de Gubernatis, Angelo, 1882 :La Mythologie des plantes et les légendes du règne végétal, Seconde partie, Botanique spéciale, Paris, C. Reinwald.
Haas, Volkert, 1994 : Geschichte der hethitischen Religion. Handbuch der OrientalistikV, Erste Abteilung : Der Nahe und Mittlere Osten,Leyde - New York - Cologne, Brill.
Halloweel, Alfred Irving, 1926 : « Bear Ceremonialism in the Northern Hemisphere », American Anthropologist, 28, 1-175.
1.Exampli gratia : Alp, 1947 ; Gonet, 1981 ; Alföldi, 1974, 181-219 ; Masson, 1996, 29-30, 36 ; Freu, 1997, 307 ; Blaive, 1999, 38-39 ; Mazoyer, 2003, 151 ; Bader, 2006, 187.
2. E. Masson avait déjà comparé les Lupercales à un groupe de rites hittites (1996, 36) ; ces parallélismes étaient moins frappants que ceux que l’on va mettre en lumière entre Lupercales et fête de Tetewatte.
3. Ti-ti-ut-ti-iš KUB [= Keilschrift Urkunden aus Boghaz-Köy] XXXVIII 14 Ro [recto] 1
Ti-ti-ut-ti KUB XXXVIII 14 Ro 5
Ti-ti-ú-ut-ti KUB II 3 II 17, 21
Ti-ti-wa-at-ti KBo [= Keilschrift Texte aus Boghazöi] XXIII 97 Ro I 6, 12, Vo 6’ (en hatti)
Te-te-wa-at-ti KBo XXIII 97 Ro I 7, 12, 15
a-ti-wa-at-ti KBo XXIII 97 Vo 9’ (en hatti)
Ti-ti-w[-a KBo XXIII 97 Ro I 26
Ti-ti-ú-ti-ti KUB LX 111 r. 4’- et inscriptions fragmentaires (Pecchioli Daddi, 1992, 101, 108).
4. L’étymologie du nom, très incertaine, n’est d’aucune aide. Le rapprochement fait entre -watteet katte, « roi, reine », est sans justification. Laroche, 1947, 35, donne le sens de « Grand » à l’élément tete- ; mais si l’on admet avec Pecchioli Daddi, 1992, 108, que tete- est un adjectif féminin dont la forme masculine est *teli, celui-ci pouvant avoir le sens de « Fort » (Mazoyer, 2003, 212, 319), Tetewatte serait « -watteforte » !
7. Sur les Lupercales, Frazer, 1929, 337-338 ; Dumézil, 1929, 95-222 ; Altheim, 1938, 213 ; Kerényi, 1949 ; Rose, 1949 ; Nilsson, 1958 ; Bömer, 1958, II, 100 ; Piccalugga, 1962 ; Dumézil, 1966, 564-565 ; Wiseman, 1995.
15.Cf. Haas, 1994, 341, 348, 357-358 (lien avec Ištar-Šawoška), 438, 502 (lien avec la déesse Hatepuna, déesse qui exprime les eaux courantes,épouses de Telipinu, dieu à fonction agraire, et les sources), 749, 765, 888. À Athènes les prostituées célébraient la fête des Adônia (Detienne, 1972). En Inde, les devadāsi, prostituées sacrées, se trouvaient principalement dans les temples de Śiva. Cf., aussi, dans les récits bouddhistes, le rôle de la courtisane Āmrapālī, riche nourricière du Bouddha, et épouse commune du groupe princier des Licchavi (Dumézil, 1983, 31-35). Dans les légendes romaines sur l’origine de la ville, les anciennesmeretricessont des mères, et des riches (cf. Dumézil, 1954, 3-5).
17. Dumézil, 1954, 8, au sujet de Goewin, et de même Sterckx, 1994, 25 ; Müller, 1991, passim. C’est cette conception qui éclaire, à Rome, par exemple, le fait que les vierges Vestales allaient puiser de l’eau à la source Egeria, la nymphe de cette source étant une ancienne déesse des accouchements (Dumézil, 1966, 397).
25. Woodhuizen, 1996. De nos jours, en gros, les linguistes sont favorables à un rattachement de l’étrusque à l’indo-européen, alors que les philologues et les historiens ne veulent pas en entendre parler.
26. Bosch, 2013, 132 ; Pauvert, 2014 ; il y a aussi des points communs précis entre certains rites carnavalesques et des rites des Lupercales : Mannhardt, 1875, 544 (citant Sebastin Franck,Weltbruch, 1534, comparant les Lupercales à un rite de carnaval franconien) ; Gubernatis, 1882, 317 ; Coussée, 1994, 42 ; Pauvert, l. c., 24-25, pour des carnavals basques. Le carnaval, connu en Afrique du nord, en Sibérie, sinon même en Amérique, est lui aussi une fête pré-indo-européenne. Et cela rend compte de l’interférence entre bouc et loup dans les Lupercales : en Europe orientale et balkanique, la chèvre intervient dans les rites carnavalesques ; chez les Khantes de Sibérie occidentale, Kaça, associée au rituel de l’ours, est « le bélier » ou « le bouquetin mâle » ; à Bielsa en Aragon les Trangas qui doublent les ours ont de grandes cornes, et en pays basques les ours portent souvent des cornes de caprin (Pauvert, 2014, 24-25).
27. L’enquête essentielle est celle d’Hallowell, 1926 ; ajouter Montandon, 1937, 153, 174, 234 ; Kannisto, 1939, 21-23 ; Harva, 1959, 282 ; Paulson, 1965, 83 ; Diószegi, 1968, 175 ; Eliade, 1968, 183-184, 353, 357 ; Krejnovič, 1971 ; et Études mongoles et sibériennes, 11, n° spécial, L’ours, autre de l’homme,1980, avec les études de Boris Chichlo, « Travaux soviétiques récents », Laurence Delaby, « Mourir pour vivre avec les ours », Annes de Salles, « Deux conceptions de l’alliance à travers la fête de l’ours en Sibérie », G. M. Vasilevič, « À propos du culte de l’ours chez les Evenk » ; et aussi Boris Chichlo, « L’ours-chamane », Études mongoles et sibétiennes, 12, 1981, 35-112 ; Mathieu, 1984, 24-25 ; Lajoux, 1996, 189-198. Que les fêtes de l’ours pyrénéennes se relient à cet ensemble est parfaitement démontré par Pauvert, 2014.
30.Id., 34.
31. À la demande d’Antoine Meillet, Dumézil avait inclus un paragraphe sur les Lupercales dans ce livre, car, pour le grand linguiste, le mot februumdevait être apparenté à Gandharva, mot qui, à son tour, était relié à Kentaúros.