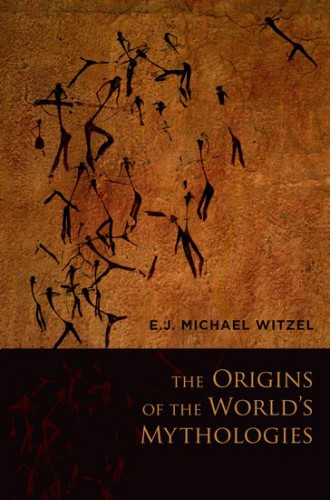 E. J. Michael Witzel, The Origins of the World's Mythologies, 2013, Oxford, Oxford University Press.
E. J. Michael Witzel, The Origins of the World's Mythologies, 2013, Oxford, Oxford University Press.
Cela fait des années, pour ne pas dire plus, que la mythologie comparée est une discipline qui tourne un peu en rond, faute d'idées porteuses, de méthodologies nouvelles. Les chercheurs, sans démériter aucunement, se contentent de s'installer dans les schémas pré-établis par Georges Dumézil pour le monde indo-européen, ou Claude Lévi-Strauss ailleurs. On consolide des idées anciennes, mais l'on ne va pas de l'avant. Et pourtant, de nouveaux moyens venus des sciences dites dures permettent depuis des années d'envisager les choses d'une nouvelle manière. Les bases de données, les systèmes d'information géographique, la génétique des populations et ses outils statistiques permettent d'approcher les mythes d'une façon non plus totalement subjective, mais en y apportant une réelle objectivité. Cette approche étant encore récente, on peut saluer la publication d'un volumineux essai employant ces méthodes, par un sanskritiste reconnu, E. J. Michael Witzel, et chez un éditeur scientifique de premier plan au niveau mondial, Oxford University Press.
Malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur de nos attentes. En effet, l'auteur n'entend pas exactement présenter une nouvelle approche de la mythologie comparée, mais défendre une hypothèse en utilisant pour cela cette nouvelle approche. Autrement dit, il part d'un a priori, a priori qu'il va tâcher de démontrer tout au long des 665 pages du livre.
L'idée de s'appuyer sur un énoncé scientifique a priori qu'il faut par la suite tester n'est pas forcément anti-scientifique, et rejoint une proposition de Karl Popper selon lequel tout peut être énoncé en science, pourvu que chaque énoncé soit rigoureusement testé par la suite, et résiste aux tests successifs. Quel que soit son succès face aux tests, l'énoncé n'est de toute façon jamais prouvé, mais seulement un peu plus corroboré. On peut donc considérer l'énoncé de E.J. Michael Witzel comme un programme, qui nous indiquerait dans quel sens orienter nos travaux, et quel type d’explication serait de nature à nous satisfaire.
La proposition a priori de Michael Witzel est qu'il existerait deux types de mythologies, l'une dite du Gondwana, existant donc en Afrique, autour de l'Océan indien et en Australie, et l'autree dite de Laurasie, couvrant l'Europe, l'Asie et les Amérique. Cette dernière serait plus récente que la première, car apparue lors de la sortie d'Afrique par l'homme moderne, il y aurait 100 000 ans de cela. Ces deux mythologies enchaîneraient chacune une séquence d’événements dans un ordre intangible. Celles de type laurasien auraient en commun de raconter l'histoire de l'univers depuis sa création, avec plusieurs générations de divinités agissant au cours de plusieurs grands âges et jusqu'à la fin du monde, alors que tous ces éléments seraient absents des mythologies de type gondwanien, qui commenceraient après la création du monde.
L'idée est séduisante, mais se heurte vite à de nombreux problèmes. Durant près d'une centaine de pages, l'auteur répète régulièrement que ces deux mythologies existent, mais sans le démontrer, ce qui laisse craindre des hypothèses et des constructions ad hoc. Clamer n'est pas prouver. Mais ce qu'il faut craindre le plus dans ce genre d'entreprise, qui couvre les mythologies du monde entier, est une méconnaissance des différents dossiers abordés afin de servir à étayer la théorie de base. C'est un risque, commun à tout chercheur abordant la mythologie comparée, dont l'auteur a particulièrement conscience, comme il le dit clairement p. XII, mais qui aurait pu être partiellement levé en consultant les divers spécialistes des mythologies locales. Cela ne semble malheureusement pas avoir été le cas.
Pour étudier la géographie mythique du monde, Michael Witzel est obligé de découper celui-ci en grandes aires culturelles (p. 68, par exemple). Mais là où l'on se serait attendu à un travail de fond, permettant d'offrir un critère de classement des mythes étudiés ensuite, le lecteur ne dispose plus que de quelques généralités. Ainsi, l'auteur divise l'Extrême Orient en Chine, Koguryo, Corée, Japon. L'extrême orient sibérien n'existe pas, pas plus que l'Asie du Sud-Est. Quant à Koguryo, qu'il érige en aire importante, c'est un ancien royaume de la Corée antique et médiévale, où l'on parlait un dialecte coréen. Mais comme à ce sujet, Michael Witzel a seulement lu l'ouvrage de Christopher Beckwith (2004), qui voulait faire de la langue du Koguryo un parent continental du proto-japonais (ouvrage qui n'a finalement guère été suivi : voir par exemple la réfutation de Pellard 2005), il détache arbitrairement ce royaume, quand il aurait fallu créer un ensemble coréano-toungouso-mandchou. Il en est finalement de même pour l'ensemble des aires géographiques proposées, toutes plus ou moins incomplètes ou arbitraires.
Et les dossiers mythologiques qui suivent sont à peine mieux traités. Ainsi, p. 86-87, Michael Witzel parle du mythe « laurasien » des quatre âges du monde (ou de l'humanité). Selon lui, on trouve finalement cinq âges en Grèce, et en Mésoamérique. Il ne connaît donc pas la mythologie celtique, et notamment les cinq invasions de l'Irlande. Une information que l'on trouve pourtant dans nombre de livres de vulgarisation.
Au-delà de ce type de lacunes, il est possible aussi de relever des approximations. Ainsi l'auteur considère-t-il Zoroastre comme un personnage historique, ce qui est loin d'être admis (Sergent 2005). Lorsqu'il aborde la mythologie grecque, il le fait souvent par le prisme de Robert Graves, un auteur qui n'hésite pas à surinterpréter ses sources pour reconstruire une « mythologie pélasge », donc antérieure à l'installation des Hellènes en Grèce (p. 108, par exemple).
Lorsque Michael Witzel s'attaque à un mythe fondamental, auquel Calvert Watkins (1995) a consacré un monumental essai, le mythe du combat contre le dragon, il évacue cela en cinq pages très générales, basées sur une poignée de versions, sans faire la moindre typologie des dragons – or on se doute bien que le dragon ailé occidental est différent du cavalier polycéphale doté de trompes des Russes ou de l'escargotte géante des Indiens Shipibos –, ou de leurs adversaires. Il ne questionne pas le mythe dans toutes ses variations. Par ailleurs, il oublie de citer certains de ces prédécesseurs, qui avaient déjà noté la proximité entre les combats contre le dragon en Eurasie, en Amérique du Nord et en Amérique centrale (par exemple, Fontenrose, 1980). Ce n'est là qu'un exemple de son absence de prudence. Notons par exemple, que p. 219, il écrit : « much of mythology has been transmitted by men », et p. 237 : « mythology [… is …] similar with both the male and females of a given population ». La première affirmation est assez imprudente et demanderait à être davantage étayée, car la seconde est fausse dans sa généralité, ainsi que l’ont montré les Berndt pour l’Australie. Il faut tenir compte du fait que la majorité des recherches ont été effectuées par des hommes qui n’avaient pas accès aux traditions féminines. Ainsi, on a longtemps cru qu’en Australie la mythologie était essentiellement une affaire masculine, jusqu’à ce que, pendant que son mari Ronald recueillait les mythes transmis par les hommes, comme l’avaient fait avant lui nombre de chercheurs (introduisant ainsi un filtre masculin dans les études) Catherine Berndt collecte ceux qui n’étaient transmis que par les femmes, et qui se comptent par centaines (Berndt et Berndt 1994) ! Les lacunes aux fondements de l’œuvre sont ainsi nombreuses, et fragilisent considérablement l'ouvrage.
Les connaissances en préhistoire de l'auteur semblent tout aussi problématiques, alors que l'objectif fixé par l'ouvrage est pourtant bien de reconstituer des idées, des mythes paléolithiques très anciens.
P. 234, l'auteur déclare: « there is some overlap with early rock art found in France/Spain, the Sahara, Central India, and Timor, but also in South Africa, New Guinea, and Australia, which needs to be explained », une affirmation qui ne peut que surprendre tous les spécialistes. L’auteur renvoie à ses § 4.4.1 et § 7.1.2. De même p. 242: « Another close correlation can be established, in spite of certain problems of interpretation, between reconstructed Laurasian mythology and early (late Paleolithic) cave paintings of France ad Spain and between the early cave art of Australia and Gondwana myth (§4.4.1, §7.1.1). »
Or que nous dit-il dans les paragraphes en renvoi? Il considère que l’art rupestre saharien est paléolithique, comme aussi, dans leur ensemble, les arts rupestres d’Afrique australe, de l’Oural et de l’Inde centrale. Une telle généralisation est inacceptable. Dans le détail, par exemple, ses sources d’informations pour le Sahara sont obsolètes, car il persiste à penser que le « Bubalin » constituerait une « phase » particulière (p. 527, n. 338), alors que cette position intenable a été réfutée depuis plus de vingt ans (voir par exemple Le Quellec 2013). Il reprend d’une manière extrêmement naïve le vieux dossier des « béliers à sphéroïdes » du Sahara (p. 267) en acceptant sans discussion l’hypothèse – pour le moins risquée – selon laquelle ces animaux porteraient un disque solaire (contra: Muzzolini 2001 ; Le Quellec 2001).
Il regarde l’art paléolithique en général comme l’effet d’une « explosion » survenue vers 40 000 ans et que rien n’annonçait. Certes, il mentionne les découvertes de tracés géométriques de Blombos Cave, datée de 75 000 ans, ainsi que plusieurs autres découvertes similaires effectuées en Afrique australe et antérieures à 60 000 ans, mais il maintient l’expression « artistic explosion » (p. 253) sans tenir aucun compte des questions de taphonomie, et surtout en ignorant complètement l’important article de Sally Mcbrearty et Alison S. Brooks, qui ont consacré plus de cent pages à réfuter cette idée d’une « explosion » ou « révolution » artistique et cognitive (2000). Pire, il reprend des théories qui avaient encore parfois cours au début du XIXe siècle, comme celle qui veut que les Khoi-San seraient parti d’un Sahara verdoyant mais au climat déclinant, pour se rendre en Afrique australe en passant par la Tanzanie : certes, il n’est pas interdit de vouloir réhabiliter des thèses généralement tenues pour réfutées, mais en ce cas l’usage est quand même de proposer des arguments en leur faveur, ce que Michael Witzel, ici, ne fait pas, car il ne procède que par affirmations. Parlant des grottes ornées franco-cantabriques il va jusqu’à affirmer sans ambages (p. 255) que « the interest of the early cave painters was […] quite obviously in depicting hunted, wounded, and procreating animals »! Passe encore pour les animaux blessés, bien que cela mérite discussion et que les images ainsi interprétables soient très minoritaires (d'Huy et Le Quellec 2010), mais comment peut-il ignorer qu’il n’existe dans les grottes aucune peinture représentant indiscutablement la moindre scène de chasse, et qu’on serait bien en peine de trouver, dans tout l’art pariétal européen, une seule figuration de « procreating animal » ?
Enfin, il tient pour acquis que l’art paléolithique aurait été une affaire de chamanes, et multiplie les affirmations non prouvées, comme celle-ci: « Sacrifice seems to have developed from an early connection with shamanic hunting magic that developed in both Laurasian and Gondwana cultures » (p. 263). Pour cela, il ne s’appuie que sur un livre de vulgarisation – encore – publié (en 1988 !) par Joseph Campbell, bien connu pour accumuler lui aussi les généralisations hâtives: n’y aurait-il eu aucune étude sur ces sujets depuis la parution de ce livre ? Parmi les théories anciennes ressuscitées au passage figure celle de la « diffusion des mégalithes » (p. 271), mais fort heureusement, Witzel ne s’y attarde pas.
Manifestement, l’auteur ne maîtrise pas du tout le dossier des arts rupestres, sa documentation est trop ancienne, partielle et partiale. Plutôt que de renforcer sa thèse, l’usage qu’il fait de ce dossier ne peut que l’affaiblir aux yeux de tout connaisseur. Et si l'on interroge ses connaissances sur des périodes encore plus anciennes, le constat est similaire. Ainsi, plutôt que de corriger son ouvrage après avoir eu connaissance de récentes découvertes concernant les hommes de Néandertal, il préfère les ignorer purement et simplement (p. XVIII). De la même manière, il ne considère que deux « humanités », celle d'Afrique, et celle – de l'homme moderne – sortie d'Afrique. Quid des êtres humains qui ont quitté précédemment ce continent, ces multiples formes issues d'Homo erectus archaïques ? Auraient-ils été totalement dépourvus de mythes ? N'auraient-ils pu interférer avec des hommes dits modernes venus plus tard ? Après tout, Neandertal nous a transmis une partie de ses gènes (Green et al. 2010 ; Prüfer et al. 2014) ; pourquoi pas une partie de ses mythes ? Pour échanger ses gènes, il faut d'abord se comprendre. La chose était d'autant plus importante qu'une influence néanderthalienne pourrait expliquer une partie de la mythologie laurasienne (voir une première hypothèse dans Lajoye 2006). Pourtant, Michael Witzel ne pose même pas la question. Et pour ce qui concerne cet homme « moderne », l'Eve africaine aurait vécu, selon l'auteur, vers 130 000 ans, et la sortie d'Afrique daterait de 65 000 ans. Si la première date est, en l'état, à peu près exacte (même si, depuis la découverte d'Homo sapiens idaltu, on est bien obligé de rechercher une date antérieure), la deuxième est fausse. L'auteur ignore les découvertes de Qafzeh et de Skhul (Israël, 120 000/90 000 ans), pourtant célèbres, ou celles de Liujiang (Chine, vers 68 000 ans).
Au-delà de toutes ces critiques sur les données, il faut aussi s'attarder sur la forme de l'essai. Michael Witzel prétend à la réfutabilité, ce qui le place, avons-nous vu au début du texte, dans une approche poppérienne de la science. Pourtant il ne cesse de trouver des hypothèses ad hoc pour sauver sa théorie lorsque les faits ne sont pas en accord avec lui : il sélectionne la littérature en sa faveur, tout en organisant sa défense. Ainsi, selon l'auteur, pour faire s'effondrer sa théorie, il ne suffirait pas que les contre-exemples concernant la diffusion d'un mythème en particulier se multiplient, mais que l'organisation des mythèmes qu'il a sélectionné ne se retrouve plus (p. 281). Pour procéder par analogie : qu'importent si les briques utilisées pour construire une voiture Lego se retrouvent dans d'autres boîtes, pourvu qu'elles ne servent à construire qu'un seul modèle de voiture.
L'auteur paraît avoir senti la faille de sa théorie. Parmi les motifs qu'il étudie, le déluge est universel, idem pour le Trickster amenant la culture aux hommes (presque universel), le Dieu créateur se retrouve en Afrique (mis en note, p.474), et on y trouve aussi des récits de création, par exemple chez les Bambara (ces motifs sont donc bien présents dans un secteur où, selon Michael Witzel, le monde serait éternel)... Aucune carte, aucun relevé précis, ne permet par ailleurs de vérifier que certains motifs sont bien plus répandus dans une partie du monde que dans l'autre. La base des énoncés est donc bien fragile.
Si l'on admet qu'importent peu les briques et que c'est l'organisation des mythèmes entre eux qui est importante, force est de constater qu'il est rare de trouver ensemble les différents éléments de la cosmologie proposée. Michael Witzel, bien conscient du danger, propose afin de le contrer quelques hypothèses ad hoc :le peuple aurait oublié, ou modifié, son héritage. Le raisonnement de l'auteur se fissure davantage encore : si seul compte le plan, on ne le retrouve pas partout, là où justement son omniprésence devrait garantir la division du monde en deux grands schèmes mythologiques. Face à ces difficultés, Michael Witzel décide de réduire la structure laurasienne au maximum, en la définissant comme un schème allant de la création à la destruction du monde, et en précisant que les grands événements qui doivent se dérouler entre ces deux extrêmes ne sont pas obligatoires (p. 283). Ce recul pose encore problème : en effet, jamais n'est démontré le fait que la croyance en un début et une fin de l'univers aurait été plus importante, aux yeux des peuples paléolithiques, que par exemple le déluge. Dans ces conditions, pourquoi les privilégier ? Par ailleurs, le début de l'univers et sa déflagration finale ne se retrouvent pas partout en Laurasie, par exemple chez les Eskimos. La rigueur autoproclamée de Michael Witzel ne doit donc pas faire illusion. Les lacunes logiques sont nombreuses dans son ouvrage, et suffisent à elles seules à faire douter des fondements de sa théorie.
Il aurait été pourtant facile d'étayer l'analyse statistiquement, en calculant le pourcentage de co-occurences de chaque mythème en plusieurs points bien définis du monde. Ou même d'étudier plusieurs ethnies avec précision et de les mettre en regard dans un tableau. Cela n'a pas été fait (ou quand cela a été fait, par exemple pour le tableau du Gondwana, cela reste très peu convaincant, avec de nombreuses cases vides). Au contraire, le lecteur fait face à une accumulation d'éléments en faveur de la thèse de l'ouvrage, sans que l'auteur cherche à réellement tester celle-ci. Or une collection d'observations (« Je n'ai vu jusqu'à présent que des cygnes blancs ») ne permet pas d'induire logiquement une proposition générale (« Tous les cygnes sont blancs »), car une seule observation contraire (« J'ai vu passer un cygne noir ») invalide la proposition générale.
En résumé, la série d'éléments proposés comme typiques de la mythologie laurasienne selon Michael Witzel se retrouve rarement en un seul lieu, et la co-occurence de quelques éléments par ci, par là, est problématique, car, si certains motifs sont universaux, cette cooccurence peut se retrouver ailleurs que dans la région où elle est censée se produire. Ainsi Michael Witzel reconnaît lui-même que des éléments de séquence de la mythologie laurasienne se retrouvent en terre gondwanienne (p. 283, 344-347), en expliquant que ce n'est pourtant pas un problème important, mais sans expliquer véritablement pourquoi. En réalité, ce ne serait pas significatif si Witzel avait prouvé que la co-ocurrence de ces motifs était nettement moins fréquente au Gondwana qu'en Laurasie, ce qui n'a pas été fait.
Contrairement à ces dires, Michael Witzel semble finalement bien décidé à ne pas laisser sa théorie se faire réfuter, puisqu'il ne propose grosso modo au lecteur que deux solutions : 1/ soit les données confirment la théorie, 2/ soit la théorie doit s'adapter. Il oublie la possibilité que sa théorie s'effondre. Le livre adopte alors un souffle prophétique.
Venons-en à la cladistique, l'un des maîtres mots de l'ouvrage. Selon l'auteur, la mythologie comparée doit prendre la forme d'un arbre représentant l'évolution des mythes humains (p. 3, 17). L'idée est intéressante, et a été développée en s'appuyant sur des outils statistiques depuis 2012 (d'Huy 2012 ; d'Huy et Le Quellec 2014) Mais quand Michael Witzel tente de reconstituer l'arbre laurasien, il se contente en réalité de reprendre des arbres linguistiques pour étayer l'ensemble (p. 80 et suiv.), en s'appuyant extrêmement peu sur des analyses proprement phylogénétiques. Or cela implique une évolution simultanée de la mythologie et des langues, ce qu'il ne démontre pas. Par ailleurs, les familles de langue qu'il utilise dans l'ouvrage sont discutables (Nostratique, Dene-Caucasien, etc.). De même, s'il parle de « mutations » affectant les récits, le terme n'est pas défini.
Par ailleurs, l'auteur oublie qu'accepter cette méthode implique que tous les récits appartenant à l'aire laurasienne doivent évoluer simultanément – en même temps que les peuples? –, ce qui interdit de les considérer séparément ; ce que Michael Witzel fait pourtant puisqu'il les aborde individuellement. Il faudrait montrer que les mythes évoluent simultanément, et non chacun de leur côté. Il serait facile de le tester statistiquement à partir d'arbres créés en utilisant des outils propres à la cladistique, mais ce que fait Michael Witzel ne relève pas de cette discipline. Il est ainsi difficile de comprendre comment les arbres des pages 67 et suivantes ont été obtenus. Ajoutons qu'il n'aborde pas le problème de l'émergence spontanée de motifs mythologiques semblables en plusieurs points du monde, surtout quand le mythème est simple (par exemple, le déluge).
Il semble au final que Michael Witzel ait généralisé ses intuitions sans prendre la prendre la peine de faire de véritables démonstrations. Il a, comme Yuri Berezkin que nous avons récemment accueilli dans nos colonnes, mis le doigt sur de véritables différences de distributions géographiques qu’il faut expliquer, mais à la différence du premier, il s’est obstiné à reconstituer deux grands mythes dont la préhistoire, l’histoire et l’évolution rendraient compte de la situation actuelle. Ce n’est sans doute pas entièrement faux, mais il est prématuré de l'affirmer, surtout de manière péremptoire et schématique. Il paraît hautement préférable, du moins pour l’instant, de se contenter d’étudier la diffusion de certains mythes et motifs.
Julien d'Huy, Patrice Lajoye et Jean-Loïc Le Quellec
Christopher I. Beckwith, Koguryo. The Language of Japan's Continental Relatives. An Introduction to the Historical-Comparative Study of the Japanese-Koguroic Languages with a Preliminary Description of Archaic Northeastern Middle Chinese, 2004, Leiden, Brill.
Ronald Murray Berndt et Catherine H. Berndt, The Speaking Land. Myth and Story in Aboriginal Australia (SL), 1994, Rochester (Vermont), Inner Traditions International.
Joseph Fontenrose, Python. A study of Delphic myth and its origins, [1959] 1980, Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press.
R.E. Green, J. Krause, A. W. Briggs, T. Maricic, U. Stenzel, M. Kircher, et al., « A Draft Sequence of the Neandertal Genome », Science, 328 (5979), 2010, p. 710–722.
Julien d'Huy, « Un ours dans les étoiles, recherche phylogénétique sur un mythe préhistorique », Préhistoire du Sud-Ouest, 20 (1), 2012, p. 91-106.
Julien d'Huy et Jean-Loïc Le Quellec, « Les animaux "fléchés" à Lascaux: nouvelle proposition d'interprétation », Préhistoire du Sud-Ouest, 18(2), 2010, p. 161-170.
Julien d'Huy et Jean-Loïc Le Quellec, « Comment reconstruire la préhistoire des mythes ? Applications d’outils phylogénétiques à une tradition orale », in P. Charbonnat, M. Ben Hamed and G. Lecointre (dir.), Apparenter la pensée ? Saisir l’évolution et la phylogénie des concepts savants, 2014, Paris, Editions Matériologiques, p. 145-186.
Patrice Lajoye, « Borgne, manchot, boiteux : des démons primordiaux aux dieux tonnants. Une problématique indo-européenne ? », Ollodagos, XX, 2006, p. 211-245.
Jean-Loïc Le Quellec, « Les arts graphiques du Sahara et de l'Égypte: que comparer ? », in Josep Cervello Autuori (éd.), Africa antiqua. El antiguo Egypto, una civilizacion africana, 2001, Barcelone: Aula AEgyptiaca studia, p. 159-178
Jean-Loïc Le Quellec, « Périodisation et chronologie des images rupestres du Sahara central » Préhistoires Méditerranéennes 4, 2013, en ligne à http://pm.revues.org/715)
Sally Mcbrearty et Alison S. Brooks, « The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior », Journal of Human Evolution, 39 (5), 2000, p. 453-563.
Alfred Muzzolini, « Les relations entre l'Égypte et le Sahara aux temps néolithiques », in Josep Cervello Autuori (éd.), Africa antiqua. El antiguo Egypto, una civilizacion africana, 2001, Barcelone, Aula AEgyptiaca studia, p. 205-218.
Thomas Pellard, review of Beckwith 2004, Korean Studies, 29, 2005, p. 167-170.
K. Prüfer, F. Racimo, N. Patterson, F. Jay, S. Sankararaman, S. Sawyer, et al., « The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains », Nature, 505 (7481), 2014, p. 43–49.
Bernard Sergent, « Merlin et Zarathushtra », Ollodagos, XIX, 2005, p. 7-50.
Calvert Watkins, How to Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics, 1995, Oxford, Oxford University Press.