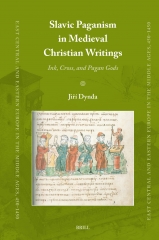 Jiří Dynda, Slavic Paganism in Medieval Christian Writings. Ink, Cross, and Pagan Gods, 2025, Leiden, Brill
Jiří Dynda, Slavic Paganism in Medieval Christian Writings. Ink, Cross, and Pagan Gods, 2025, Leiden, Brill
On assiste depuis quelques années à un renouveau de publications en anglais de travaux importants sur la mythologie et la religion des Slaves païens. Citons par exemple le recueil de sources édité sous la direction de Juan Antonio Álvarez-Pedrosa1 ; l’essai sur les rituels par Juan Antonio Álvarez-Pedrosa et Enrique Santos Marinas2, celui sur la religion des Slaves de l’Ouest selon les sources allemandes par Stanisław Rosik3. Le chercheur tchèque Jiří Dynda s’insère maintenant dans ce courant, après avoir publié quelques excellents articles ainsi que de remarquables monographies en tchèque. Le présent ouvrage est en quelque sorte une synthèse mise à jour issue de deux de ces monographies4.
Son angle d’étude est original : il ne s’agit en effet pas d’un livre qui traite directement de la mythologie slave, mais plutôt du regard que les auteurs chrétiens ont eu sur cette mythologie. En effet, à la différence d’autres peuples christianisés tardivement, tels que les Irlandais ou les Scandinaves, les Slaves n’ont pas écrit directement sur leur propre mythologie, et si l’on fait exception des textes de la Rus’ kyivienne, toutes les sources contemporaines des faits sont dues à des auteurs chrétiens non-slaves. Il convient donc d’examiner attentivement ces sources et d’identifier leurs éventuels biais avant de les employer dans des études mythologiques. Ainsi, Slavic Paganism in Medieval Christian Writings s’ouvre sur une introduction méthodologique remarquable montrant les différentes façons qu’ont eu les auteurs chrétiens d’interpréter les divinités païennes : évhémérisme, interpretation classica, interpretatio daemonica, et sur les diverses façons qu’on eut ensuite les chercheurs de lire ces auteurs. Cette introduction mérite clairement d’être lue pour elle seule : elle peut s’appliquer à bien d’autres domaines, par exemple l’Irlande ancienne, où là aussi toutes les sources sur la religion et la mythologie sont chrétiennes.
Le livre lui-même se scinde en trois parties qui séparent les textes non pas vraiment du point de vue chronologique ou géographique, mais du point de vue du but qu’ils visent. Dans la première partie, il est ainsi question des récits qui relatent la christianisation des derniers slaves, quand ces récits sont contemporains ou immédiatement postérieurs à cette christianisation. Le paganisme y est donc vu comme un ennemi extérieur (« Paganism as an External Enemy), car les auteurs sont tous germaniques. Cela n’empêche pas des différences entre ceux-ci. Thietmar voit les païens comme des apostats, Adam de Brême se veut plus objectif, Helmold observe les choses directement sur le terrain, tandis que les biographes d’Otto de Bamberg recueillent les paroles de ceux qui ont accompagné le missionnaire dans son travail. À cela s’ajoute le fait que cette christianisation s’est opérée différemment selon les endroits : si la Poméranie a été christianisée via des missions qui se sont déroulées plus ou moins pacifiquement, ailleurs, il y a eu une véritable croisade, parallèle à la Seconde Croisade prêchée par Bernard de Clairvaux, dont les visées étaient clairement exterminatrices.
La seconde partie aborde des sources qui ne sont pas nécessairement plus récentes, mais qui présentent ce processus de christianisation comme achevé. Il s’agit pour l’essentiel de chroniques du Moyen Âge central et du bas Moyen Âge, ainsi que de quelques textes hagiographiques dont les données relèvent le plus souvent du cliché. Seules les chroniques ont finalement un intérêt réel car elles préservent parfois des fragments de mythologie, fragments qu’il faut cependant toujours aborder en ayant à l’esprit que les auteurs ont une culture savante, inspirée d’œuvres chrétiennes ou classiques.
Enfin la troisième partie aborde les textes qui présenteraient de supposées survivances du paganisme après la christianisation. Ici, Jiří Dynda invite à se réapproprier le terme de « syncrétisme ». Pour lui, la religion qui apparaît après la christianisation, en incorporant des éléments païens, souvent au prix de transformations importantes, forme un nouveau système cohérent, et non un simple empilement de strates hétéroclites. Il s’oppose avec vigueur, et avec raison, au concept de « double foi » (dvoeverie) : le terme n’apparaît que dans un seul sermon médiéval, et il sert à décrire qui semble n’être ni plus ni moins que la religion populaire d’alors, et non une persistance secrète du paganisme aux côtés du christianisme. De la même manière, les pages que l’auteur consacre à l’examen du cas de Rod et des Rožanicy sont un modèle d’examen critique.
L’auteur insiste au fil des pages sur la possibilité d’une forme d’hénothéisme chez les Slaves : l’idée est intéressante et a le mérite d’expliquer certaines choses, comme le fait que, d’une tribu à l’autre, le dieu principal ne semble pas être le même, alors qu’on sait qu’il y a eu des divinités communes à l’ensemble du monde slave. C’est une situation qui, finalement, n’est guère différente de celle des Celtes antiques : on sait que chez ceux-ci, il y avait un grand dieu, maître du panthéon, assimilé à Jupiter après la conquête romaine, mais cela n’a pas empêché chaque cité de vouer un culte à un dieu particulier (ainsi, les Trévires vénèrent principalement Mars Lenus). De même qu’en Grèce Zeus est maître du panthéon, mais c’est à Athéna que l’Attique voue un culte particulier.
Un détail finalement dans ce livre ne m’a pas convaincu : je ne pense pas que Prove, dieu mentionné chez les Obodrites, existe. Une variante propose la forme « Prone »5, et il me semble que c’est celle-ci qu’il faut prendre en compte : Prone pourrait bien en effet n’être, comme je l’ai écrit dans ma thèse, qu’une prononciation germanique de Perun, ce qui change alors tout pour ce qui concerne la hiérarchie locale des dieux.
Mais au-delà de cette petite remarque, il faut bien garder à l’esprit que le livre de Jiří Dynda est un ouvrage remarquable, important, dû à un auteur qui a les capacités intellectuelles d’interroger les sources, quelle que soit leur langue, parfois immédiatement dans leurs manuscrits, et donc de les critiquer utilement. Tout cela sans verser dans l’hyper-criticisme : au contraire, l’auteur y reste ouvert au comparatisme. Slavic Paganism in Medieval Christian Writings est donc une belle œuvre.
Patrice Lajoye
1Juan Antonio Álvarez-Pedrosa (dir.), Sources of Slavic Pre-Christian Religion, 2020, Leiden, Brill. Cet ouvrage fait suite à une première version publiée en espagnol en 2017.
2Juan Antonio Álvarez-Pedrosa and Enrique Santos Marinas, Rituals in Slavic Pre-Christian Religion. Festivals, Banqueting, and Divination, 2023, York, Arc Humanities.
3Stanisław Rosik, The Slavic Religion in the Light of 11th- and 12th-Century German Chronicles (Thietmar of Merseburg, Adam of Bremen, Helmold of Bosau), 2020, Leiden, Brill.
4Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých pramenech, 2017, Prague, Scriptorium ; Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních, 2019, Prague, Scriptorium.
5C’est d’ailleurs celle-ci que Juan Antonio Álvarez-Pedrosa et son équipe retiennent, considérant que Prove peut être une cacographie pour Prone.